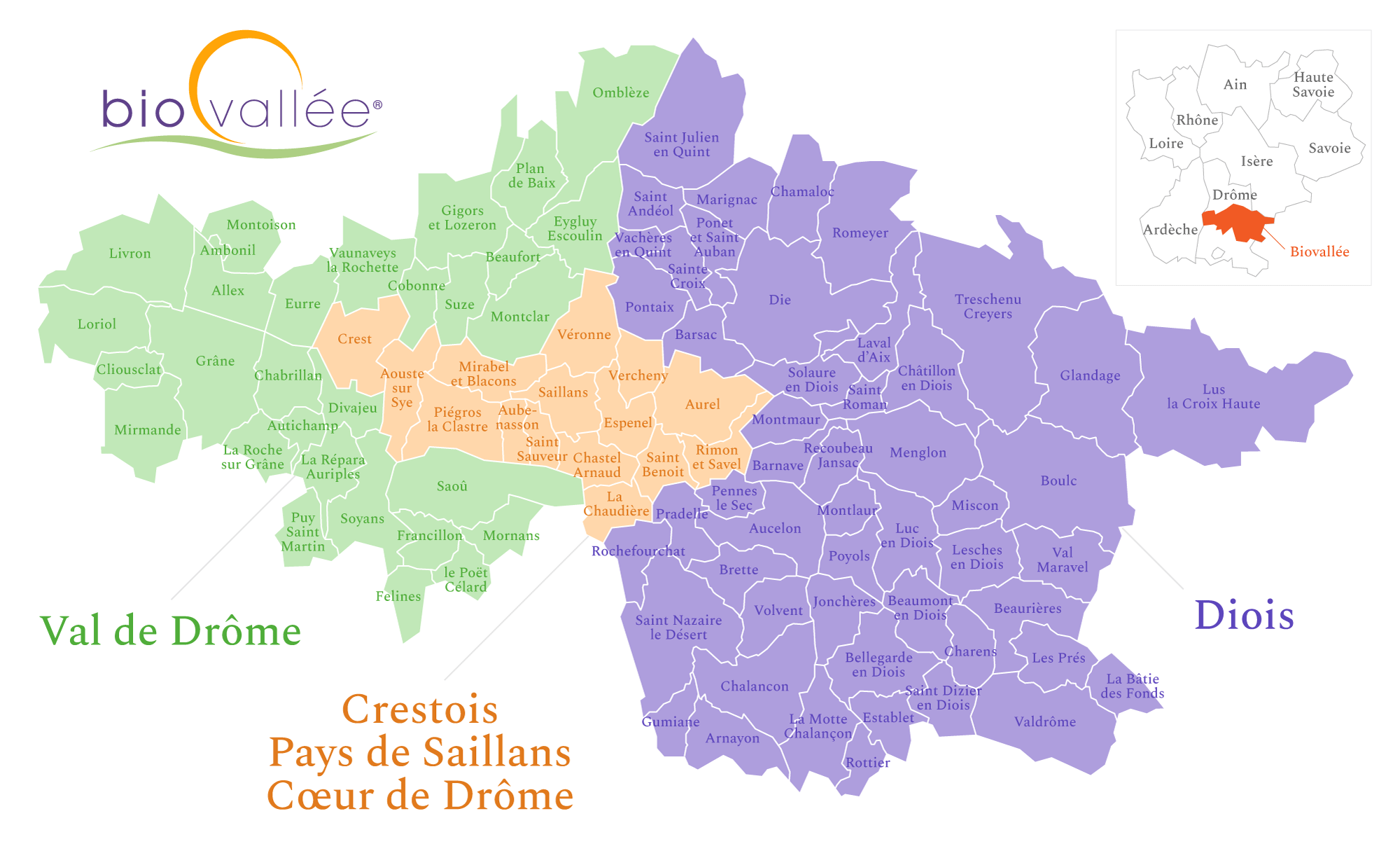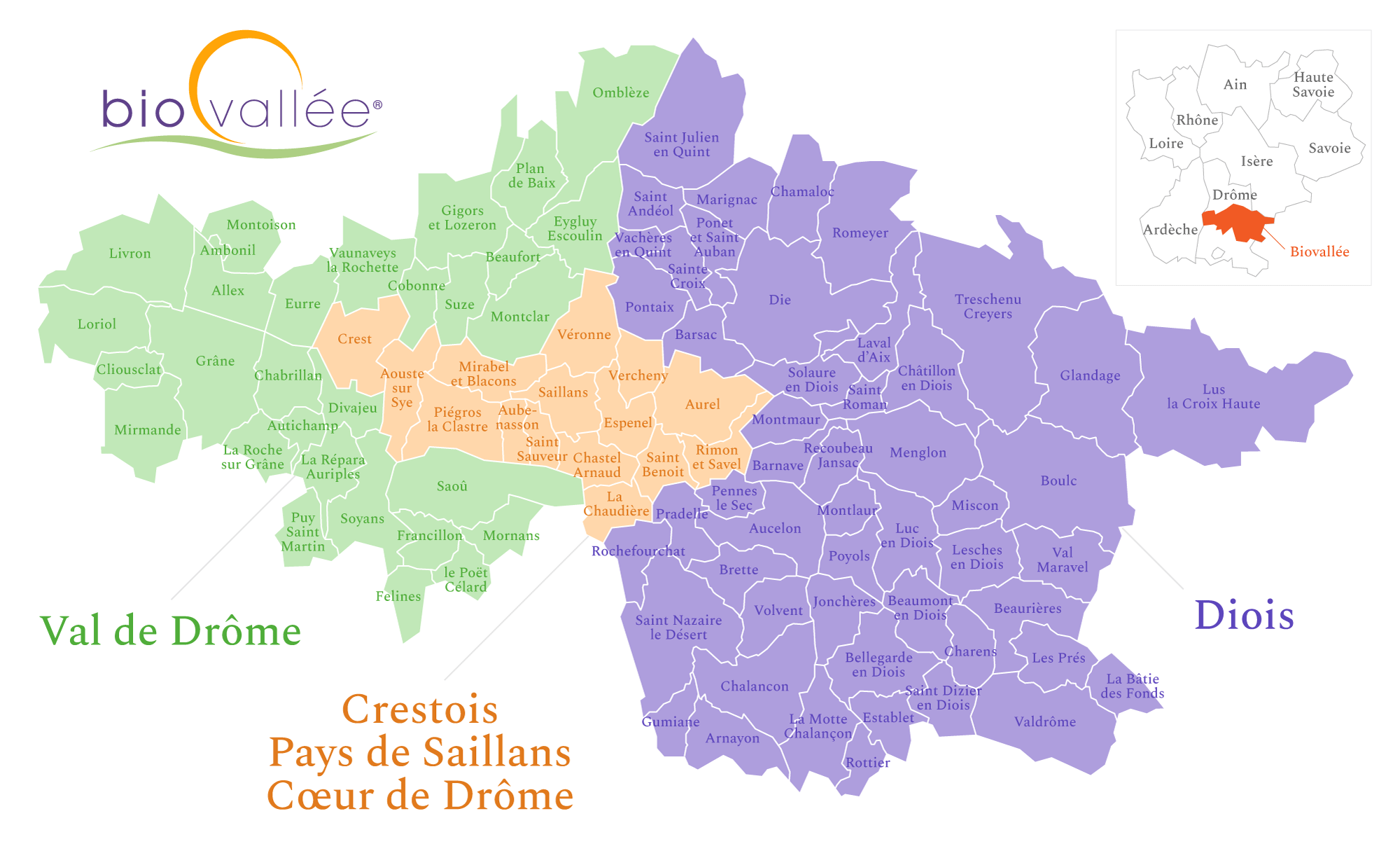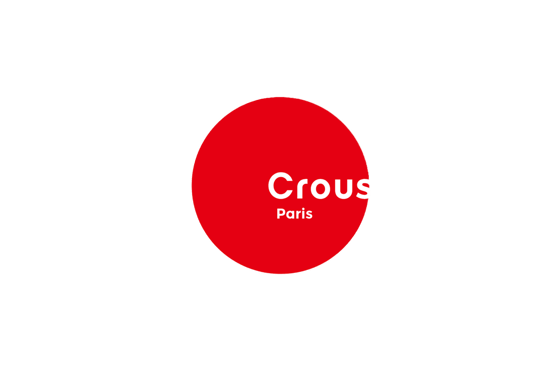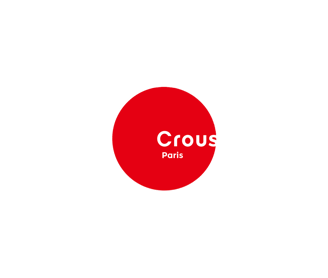Biovallée, un eldorado écolo?
Article de recherche réalisé à la suite d'une semaine de rencontres en Val-de-Drôme
Bien connue par les locaux et même au-delà, la guinguette d’Aouste-sur-Sye nous avait été conseillée par Martin, un jeune architecte que nous avions rencontré à Jabrezad en Ardèche: il nous évoquait l’ambiance particulièrement festive et les afters techno qui suivaient la soirée. Nous nous y sommes rendus et la découverte était à la hauteur de nos espérances : concert de rock, bières, et danseur.euse.s de tout âge, nous sommes rentré.e.s impressionné.e.s par l’ambiance de ce village d’un peu moins de 2500 habitants.
La Drôme est en effet connue pour son dynamisme à la fois culturel et écologique, pour sa « biovallée » située sur un territoire rural. Le collectif Ville et Décroissance, dont Rosalie faisait partie à Sciences Po, lui avait consacré un article en 2019, que nous avions lu, et qui avait renforcé notre curiosité à son propos. Surpris.es de lire qu’une alliance et une cohésion semblait bien réelle au sein de cet “eldorado”, nous nous sommes interrogé.e.s sur le fondement de cette impression et avons choisi de nous rendre sur place. Afin de rencontrer le plus d’acteur.rices possibles, nous avons décidé de faire une pause dans notre aventure d’autostoppeur.euse.s pour prendre la voiture d’Agathe et être libres de nous rendre où notre enquête nous mènerait. Toutes nos rencontres ont bien évidemment été anonymisées, les noms changés, pour respecter la vie privée des individus.
Ces questionnements sur l’émergence d’une telle dynamique s’inscrivent dans une démarche globale de remise en question des modèles plus classiques de développement territorial. Les études de sciences politiques que nous avons faites et notamment d’urbanisme (Agathe et Rosalie), au cours desquelles nous avons étudié les politiques d’aménagement du territoire, ont été des ressources pour mieux comprendre les logiques présentes et passées du territoire, mais aussi une source de désespoir ou découragement. Face aux enjeux climatiques, les politiques urbaines actuelles menées au niveau national et européen brandissent l’attractivité du territoire et la compétitivité comme étendards favorisant les investissements, la venue des cadres supérieurs et des touristes. Elles s’inscrivent dans des logiques de « croissance verte » et des objectifs de « développement durable » qui sont loin d’être à la hauteur… Même si le thème de l’urgence écologique est aujourd'hui largement abordé par les politiques urbaines mainstream, à l’instar des villes résilientes, villes zéro-carbone ou des politiques de verdissement urbain, nous restons souvent sceptiques quant à leur réelle efficacité (réduction des émissions de gaz à effet de serre sans prendre en compte nos modes de consommation ou les 8 autres limites planétaires) et à leur inclusivité sociale (péage urbain contre l’utilisation de la voiture, vignette contre les vieilles voitures polluantes, etc.).
À cette vision de l’écologie via la croissance verte nous opposons l’idée que ces politiques devraient urgemment être guidées par l’intérêt de l’environnement et de la population, par la redéfinition de nos modes de vie et de nos rapports au vivant, par l’exploration et la réalisation d’imaginaires collectifs moins individualistes, par la réduction de la production, par des politiques urbaines prenant en compte qu’il faudra se débarrasser des causes de la crise écologiques (grandes industries, investissement à fort impact environnemental, etc.). Ces politiques urbaines alternatives sont conçues selon une logique bottom-up [1] et abandonnent les logiques marchandes pour d’autres vecteurs d’organisation œuvrant avant tout pour les couches populaires déjà présentes dans les villes.
Dans la vallée de la Drôme, la Biovallée est constituée de trois communautés de communes :Val de Drôme en Biovallée (appelée CCVD) rassemble 29 communes et 30400 habitants, Le Crestois et Pays de Saillans rassemble 15 communes et 15700 habitants, et le Diois rassemble 50 communes et 11 900 habitants. Sur le territoire de la Biovallée, la part des surfaces cultivées en agriculture biologique est six fois plus importante qu’au niveau national : 32 % contre 5 %. Elle est devenue un territoire d’expérimentation sur plusieurs niveaux : agriculture, politique, expérience démocratique, éducation (alternative), réseau locaux d’entraide, etc. Cela a fait d'elle un « laboratoire d'expérimentations », qui est beaucoup étudié et considéré aujourd’hui comme un modèle dans le milieu académique. L’association Biovallée souhaite à ce propos faire de son territoire un exemple de réussite pour la gestion et la valorisation des ressources, et par le développement de l’ écologie et dans l' économie locale et durable. Rappelons cependant l’hétérogénéité du département de la Drôme, qui contient certains territoires très enclavés et dont les disparités démographiques et socio-économiques sont importantes. Nous nous prononçons donc seulement sur la partie du Val de Drôme que nous avons visitée!
Pour découvrir ce territoire nous avons été accueillis par une proche d’Agathe à Aouste sur Sye (Cf carte ci-dessous).
Pour mener cette étude, nous sommes allé.es à la rencontre d’acteur.rices, d’initiatives locales qui rompent avec les stratégies de décisions top-down classiques (soit provenant d’entités politiques et administratives sans concertation de la société civile et de la population locale), afin de nous intéresser aux conditions de l’émergence de scenarii d’adaptation à la crise écologique sur un territoire.
Dans cette étude, nous questionnons la prise en compte des particularités locales et des implications des habitant.es du territoire par ces initiatives. Il est important de préciser que le rôle de telles initiatives locales ne doit aucunement remplacer une offre de service public, le risque étant de justifier un retrait de la puissance publique et des financements qui l’accompagnent.
Notre objectif ici est d’analyser ces initiatives en montrant les liens qui existent entre les acteur.rices, et les limites du pouvoir d’action de chacun d’entre elles.eux.
Cette étude s’inscrit dans une démarche globale de remise en cause du capitalisme vert et de ses “promesses” de l'euphémisme croissance durable. Nos lectures et connaissances accumulées sur de nombreuses théories de l’écologie sociale, les approches libertaires et locales de l’écologie, la décroissance [2] sont pour nous des repères pour comprendre les manières dont un monde écologique pourrait/devrait advenir. Nos questionnements porteront sur les processus socio-historiques qui expliquent les conditions d’une conscience écologique collective, les complexités et interdépendances qui font vivre le territoire, ainsi qu’un tel dynamisme sur le territoire.
Un terreau fertile pour l'émergence d'initiatives locales, écologiques et sociales
Une dynamique historique : vers l'émergence d’une culture commune ?
Nous avons voulu interroger l'émergence de la dynamique actuelle de la vallée de la Drôme et du foisonnement d'initiatives locales de transition écologique et sociale qui caractérisent ce territoire. Son dynamisme puise notamment sa source dans le fait d’être historiquement une terre d'accueil : on note une longue tradition d’ouverture à la diversité sur le territoire en tant que lieu de passage d’une route marchande descendant vers l’Italie, son accueil de protestants, puis de républicains espagnols durant la guerre civile espagnole puis de groupes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale (maquis du Vercors et en Drôme Sud). Puis arrivent dans les années 1970 des “pionniers” (comme les surnomme Michèle de l'association Biovallée), venus des Pays-Bas, de Suisse ou d’Allemagne ainsi que de nombreuses personnes issues de la génération “soixante-huitards”. Avec des idéaux de retour à la terre et d’une recherche d’autonomie, et dans un contexte où l'exode rural s'intensifie, ils.elles rencontrent l’engouement des natifs de voir un renouveau émerger sur leur territoire : les locaux perçoivent alors en grande partie ces arrivées comme un moyen de re-dynamiser leur territoire rural qui se vide à cette époque.
Aussi, dans les années 1980, une collaboration territoriale pionnière a marqué la vallée lors de la dépollution de la rivière Drôme, fortement dégradée par les décharges à l’air libre, le déversement de produits chimiques, etc. Cet épisode a créé une forte cohésion sociale entre les différentes collectivités locales ayant œuvré ensemble vers un objectif commun de “rendre la rivière baignable”, instaurant ainsi une dynamique collective de “développement durable” et leur valant le prix Riverprize.
Par ailleurs, les perspectives d’agriculture intensive, particulièrement en vogue à cette période avec les stratégies gouvernementales de modernisation de l’agriculture (accentuées à la suite de la Seconde Guerre Mondiale puis dans les années 1960 et 1970s), n’ont pas trouvé leur écho sur un territoire marqué par la relative pauvreté des sols, le relief et la petite taille des parcelles agricoles. Dans ce contexte territorial particulier, et d’installation de pionnier.e.s aux idéaux novateurs, l'agriculture s’est rapidement attachée à la diversification des activités “innovantes”, biologiques, de petites exploitations. Le développement de la filière bio et des plantes aromatiques et médicinales (filière PAM plantes aromatiques & médicinales, avec notamment l’Herbier du Diois, créé en 1989 par les familles hollandaises Wartena et Vink) ont vite été une opportunité pour différencier l’agriculture drômoise et en faire une agriculture alternative “de qualité”, qui renforça l’identité territoriale. D’ailleurs, dès 1987 on peut voir que l’environnement est pris en compte dans la charte intercommunale du Val de Drôme. C’est ainsi que la marginalisation des défenseur.euses du bio a commencé à s’éroder , jusqu’à ce que le bio deviennent fer de lance d’une stratégie territoriale clairement affichée.
Petit à petit, toutes ces dynamiques structurent et ancrent un modèle de développement durable, terme encore largement utilisé à cette époque, sur le territoire. Hugues Vernier, de la CCVD, nous parle d’une “approche agricole du territoire”, avec une vision globale de la vie agricole, précisant: “la force de la biovallée est d’avoir eu ce discours et cette démarche (de qualité environnementale) avant les autres” (H.Vernier). Le développement important des connaissances autour de l’agro-écologie* dans la vallée découle de cette approche agricole spécifique du territoire, et a contribué à la dynamique commune décrite.
Ainsi, si "l'action publique est vouée à l’échec aussi longtemps qu’elle néglige de tenir compte de ce ciment qui “fait” la communauté" (De Shutter, 2016), ces différentes spécificités du territoire drômois ont pu contribuer à construire un récit commun ayant pour finalité de faire converger les intérêts de la population.
La dynamique drômoise, notre ressenti
Globalement, nous avons pu constater l'existence d’une forme de culture commune sur le territoire et chez les habitant.e.s, une ambiance générale palpable qui se retrouve dans toutes les initiatives que nous avons pu rencontrer - depuis les pédagogies alternatives visant à passer par l’éducation et la formation (avec le système de Bio Vallée Territoire Apprenant*, la dimension formative de l’Université des Alvéoles, etc.) jusqu’à l’organisation politique avec l’expérience démocratique de la République de Saillans, en passant par l’organisation de circuits courts sur le territoire (soutenue par l’association Agri Court ou les différentes initiatives de vente directe) ou encore les expériences de collectivisation des habitats ou des terres (à l’instar des jardins de Samare et sa gestion collective du potager, ou les oasis de Serendip et d’Alegria).
On observe ainsi une forte dynamique du secteur associatif, d’initiatives à la gouvernance horizontale ainsi qu’un réseau d’acteurs vertueux mettant l'accent sur l’entraide plutôt que sur la compétition, dans une région où l'on recense deux fois plus d’emplois dans le secteurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) par rapport à la moyenne du reste de la France.
Ainsi, si 40% des agriculteurs sont certifiés bio dans la vallée, ce n’est pas par hasard : une influence diffuse est exercée par la dynamique collective propre au territoire depuis 30 ans, tant chez les consommateurs.rices que chez les producteurs.rices ainsi que chez les citoyens.ennes. La “Biovallée”, la vallée du vivant, est certainement parvenue d’une certaine manière et à un moment donné à “faire système” avec son soutien à une dynamique pionnière de transition. Il semblerait avant tout que ce soient plusieurs dynamiques qui s’auto entretiennent et s’alimentent, venant d’une approche “bottom-up”** des acteur.rices locaux ainsi qu’une approche plus descendante ou top-down** entretenue par les pouvoirs publics. Selon les personnes que nous avons rencontrées sur le terrain, au delà d’une biovallée qui servirait plutôt à attirer des financements dont ils.elles ne voient pas forcément la couleur, notamment selon une agricultrice que nous avons interrogé, elle regrette de ne pas en voir davantage l’impact concret sur son territoire.
Malgré tout, le récit commun émerge et s’entretient avant tout par le fait de vivre sur un même territoire, se côtoyer et “se pétrit, se malaxer, se raconter des histoires, des rêves" (Samuel). Ainsi, cette construction en vue d'intérêts communs se fait par des acteurs.rices étant partie prenante d’une même dynamique territoriale, favorisant ainsi la coopération plutôt que la concurrence.
Une population demandeuse, une implication initiale des individus
Ce terreau réserve ainsi aux agriculteurs.rices bio un sort plus favorable qu’ailleurs, bien qu’il ne soit pas tout rose, grâce à une sensibilisation particulière des habitant.e.s qui joue sur leurs pratiques de consommation et sur leur organisation commune locale, ainsi qu’aux marchés. Par exemple, le Mimi Marché, d’initiative citoyenne, permet une rencontre directe et un dialogue hebdomadaire producteur.e-habitant.e. Les initiatives permettant la vente directe des producteur.rices aux consommateur.rices (telles les épiceries bio coopératives La Carline, l’Epicerie Géniale) limitent le chantage par les prix et les effets néfastes de la grande distribution sur les producteur.ices tout en étant plus représentatives du travail consacré. L’existence de l’association Agribiodrôme est tout aussi importante car elle accompagne, depuis 1987, les collectivités dans leurs projets de développement de l’agriculture biologique comme Agri Court, qui crée des circuits courts pour la production agricole locale. Ces initiatives et cette dynamique globale permettent ainsi une répartition plus équitable de la valeur économique chez les agriculteur.rice.s. Nous avons donc compris que l'émergence de cette culture partagée consiste en un cercle vertueux entre consommation et production sur le territoire, avec une population demandeuse et des agriculteur.rice.s qui sont soutenus pour se tourner vers des voies relevant davantage de l'agroécologie.
Un manque d’inclusivité sociale
Pourtant, ces dynamiques sont à largement nuancer car on rencontre un réel problème d'exclusivité sociale que nous résumons en deux points. D’une part, toutes les personnes rencontrées nous ont fait part du problème de la hausse des loyers et du foncier dans la vallée, obligeant des locaux à s’éloigner de plus en plus et requérant un certain capital économique pour rejoindre la région. D’autre part, nous nous sommes rapidement rendus compte de l’existence d’une “majorité silencieuse” et de plusieurs profils sociologiques sur le territoire qui ne se croisent pas, créant ainsi une forme d’entre-soi de la “classe écologique et alternative”, et alimentant ainsi des oppositions et divergences d’opinions. En guise d'exemple, la somme du ticket d’entrée (15 000€) pour intégrer le collectif du Château Pergaud ou encore le prix d’une agriculture biologique et locale par rapport au top-budget de Lidl, est représentatif de cette difficulté d’accès lorsque l’on est dans une situation de précarité économique.. Ainsi, une résilience écologique ne pourra pas être atteinte si une grande partie de la population n’a pas les moyens d’en être partie prenante. C’est pourquoi si cette lutte écologiste ne se couple pas avec une lutte sociale, elle aboutit à un renforcement des inégalités. C’est pourquoi un mouvement enthousiaste d'initiatives de transition n’est pas sans danger d’un point de vue social lorsque ces dynamiques deviennent apolitiques et abandonnent les idées de lutte collective et de revendication sociale.
Aujourd’hui, pourtant, face à l’urgence écologique, il semblerait que la région se “repose sur ses lauriers”, (selon certaines personnes interviewées) avec cette image désirable de pionnière datant d’il y a 20 ans, sans forcément se renouveler pour aller plus loin que les logiques d’un ancien paradigme. Les pouvoirs locaux ne sont pas encore forcément ouverts aux habitats légers par exemple, et ne vont pas jusqu’à une dynamique de bio régionalisme qui instaurerait une véritable remise en question de la trajectoire étatique et capitaliste. C’est ce que nous allons tenter de questionner ci-dessous.
Des logiques hétérogènes sur le territoire
Derrière un récit qui semblerait commun concernant la BioVallée, nous avons rencontré des visions plus ou moins radicales sur les objectifs de « transition écologique » ou « rupture écologique ». Nous avons rencontré des associations aux organisations et visions très différentes ; du Jardin de Samare prônant une vision politique engagée à la Biovallée défendant des actions davantage institutionnelles. Nous avons compris que des discours distincts se retrouvent derrière l'objectif « bio » de la vallée. D’un côté, certaines entreprises se sont tournées vers le bio et ont exporté leur production à un niveau national et international, et de l’autre, des initiatives ont toujours lutté pour un retour vers le local et/ou davantage d’horizontalité dans les organisations. Nous avons donc analysé les modèles d’actions des différents acteur.ices pour comprendre leur projet pour le territoire.
Du bio pour des objectifs de compétitivité
Comme nous l’avons précisé plus haut, dans le domaine de l’agriculture, le Diois est devenu une figure de territoire leader de l’agriculture biologique dans les années 2000, et le Val de Drôme a suivi l’exemple, afin que le bio soit une locomotive du territoire pour les entreprises et les consommateur.ices. L’agriculture biologique, d’abord considérée comme marginale, s’est entre autres développée dans un contexte de plus en plus concurrentiel et est apparue comme “une solution pour maintenir des outils coopératifs sur lesquels les agriculteurs gardent la main” [3] , garantissant aux agriculteur.rice.s et aux entreprises de rester “compétitifs”, et aux communes une certaine “attractivité”.
Prenons l’exemple de la filière PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) qui s’est fortement développée dans la vallée. Le savoir-faire unique des producteur.rice.s locaux et les variétés de plantes du territoire ont permis d’avoir des produits de qualité. Les néo ruraux, venant principalement du nord de l’Europe, ont trouvé une niche dans laquelle se développer, dans une logique d’exportation, comme Rodolphe Baltz qui a lancé Sanoflore. Le développement des entreprises de transformation sur place a notamment permis une expansion industrielle. L’hybridation des savoirs des néo ruraux - n’ayant aucune connaissance dans le domaine des plantes mais dans la commercialisation et le marketing territorial - et des paysans sur place - comme les savoir-faire traditionnels de distillation - a donc contribué à déployer le bio sur le territoire.
Cette dynamique a été renforcée par un contexte institutionnel de marketing territorial autour du développement du bio.
En 2002, le département et la CCVD (Communauté de Communes du Val de Drôme) ont créé la marque ‘Biovallée’, mais il faudra attendre 2012 pour la création de l’association du même nom, chargée de la gestion et de la promotion de la marque, dans l’objectif de gagner en visibilité et avec l’ambition de devenir un éco-territoire de référence en Europe. Le but de l’association est la mise en commun des ressources par des acteur.rice.s d’un même territoire, en vue de les économiser, de les réutiliser ou d’en améliorer l’usage face aux besoins : par exemple le partage d’infrastructures, d’équipements, etc.
Ces objectifs nécessitent des financements qui ont, entre autres, été apportés par le dispositif régional Grands Projets Rhône-Alpes (GPRA): la Biovallée disposa de 10 millions d’euros dès 2009 ayant aidé à l’émergence de 191 actions locales. Cependant, ces subventions présentent une certaine fragilité : l'arrêt des financements en 2015 et le manque d'intérêts des intercommunalités pour continuer de coopérer a mené à une crise de gouvernance de l’association Biovallée. Pour y remédier, cette dernière a participé au programme Territoire d'Innovation dès 2018 (géré par la Banque des Territoires, dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir de l’État) afin de remobiliser les acteur.rices et dépasser les freins politiques. 12,8 millions d’euros ont ainsi été versés à cinq entreprises et 5,7 millions à quinze actions différentes sous forme de subventions. Alors même que les retombées réelles de ces fonds cités de l’association ne sont pas objectivées et déclarées aux acteur.rice.s du territoire, certaines associations et collectifs s’interrogent sur les intérêts économiques et la visée d’attractivité de la marque.
Mais l’importance donnée au développement économique autour du bio et les logiques d’attractivité des dernières années sont-elles réalistes face aux enjeux environnementaux ?
Ces stratégies ont attiré des opérateurs de plus en plus nombreux et puissants économiquement (Duffaud-Prevost, 2015) comme L’Oréal et Yves Rocher. Bien qu’ayant aidé à construire une identité territoriale, ces entreprises ont poussé à une mise en compétition entre les acteur.rice.s de la filière PPAM - la logique de coopérative n’a pas duré à cause de cela malgré les efforts de Biovallée - et à une dépendance à des capitaux étrangers, dans une logique productiviste [4].
Ainsi, ce développement territorial s’inscrit dans des logiques de compétitivité et d’exportation, bien différentes des discours que nous avons pu entendre en interrogeant les acteur.rice.s que nous avons rencontré et qui ont à cœur la qualité de vie des habitant.e.s du territoire. Ces acteur.rice.s, ne s’inscrivant pas seulement dans le secteur agricole, promeuvent un mode de vie davantage écologique par des nouvelles pratiques de sensibilisation, de formation, de commercialisation et d’interaction avec la société.
Leurs buts : limiter le coût environnemental des transports par une dynamique plus territorialisée, lutter contre la hiérarchisation menant à l’exploitation des travailleur.euse.s et du sol ainsi que défendre le développement d’un réseau d’entraide.
Émergence d’une culture écologique radicale…
D’un point de vue historique, on voit l’émergence d’une culture écologique plus radicale par la société civile elle-même (Bui, 2015). Par exemple, la Carline, coopérative créée en 1989 - regroupant des bénévoles cherchant à l’origine à promouvoir le bio - s’attelle à la tâche de remplacer les produits de grossistes par des produits locaux. Cette initiative citoyenne prend de l’ampleur avec le temps : « la Carline passe de 250 à plus de 600 familles adhérentes entre 2002 et 2008 » (site de la Carline). D’après leur site, ils.elles se définissent comme une « coopérative dirigée par son écosystème. Ici, pas de patron, ni d’actionnaire : La Carline appartient aux citoyen.e.s ayant achetés des parts sociales »[2], et tente d’échapper au modèle classique de l’entreprise. Elle vise donc à promouvoir les circuits courts, tout comme l'association Agri Court que nous avons rencontré qui met en lien les agriculteur.rice.s et les client.e.s (majoritairement de la restauration collective). La juste rémunération des producteur.rice.s et la prise en compte de leur structure sont des valeurs fondamentales qu’Agri Court souhaite respecter « quitte à rogner les marges », comme nous le présente la responsable relation producteurs. Jeune diplômée ingénieure ayant quitté son travail en ville pour “retrouver du sens dans son activité professionnelle” , elle nous confie apprécier ses missions et son environnement de travail. Elle ajoute qu’ici la fin de l’année, l’association a pour but de devenir une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), un statut juridique “prenant en compte chacune des parties prenantes et permettant d’améliorer la gouvernance”.
Au-delà de la mobilisation citoyenne, on retrouve donc dans la vallée des associations qui se professionnalisent dans la transition écologique et sociale. Ces initiatives sont le symbole de domaines créateurs d’emplois qualitatifs, dont les structures sont plus horizontales que dans des entreprises classiques.
Une perception différente de la temporalité et de la radicalité de la transition est clairement visible par rapport à la vision détaillée dans un premier temps, notamment concernant la remise en question du modèle entrepreneurial et la dépendance aux cadres classiques, perception initiée par des initiatives plus radicales. Cela soulève la question de la dépendance au modèle classique de l’entreprise pour un développement local et du bénéfice qu’en retirent les habitant.es déjà présent.e.s.
Alors, qu'en est-il des revendications politiques ?
Certaines initiatives telles que les Jardins de Samare défendent un idéal démocratique et social. Cette association, pilotée par deux jeunes locaux, a transformé un terrain en friche depuis vingt ans en jardin autogéré où est appliquée la “politique par la pratique” grâce à la mise en commun des terres et la mutualisation des biens (outils, eau, etc). Sont organisés, entre autres, des journées plantation, des cours avec des élèves de l’école primaire de la commune, des évènements culturels, des ateliers les dimanches etc. pour permettre un partage des compétences et des savoirs entre bénévoles. Leur but est de former une communauté d’apprenants en leur redonnant des bases solides et de la confiance en leurs talents manuels. Cette initiative permet une éducation et une sensibilisation qui touchent plusieurs générations, mais crée surtout un espace de débat citoyen. Même si elle n’a pas d’objectif nourricier, les bénévoles défendent qu’« il faut de la diversité de modèles pour permettre l’expérimentation ».
…jusqu’à l’organisation d’institutions sociales parallèles !
C’est d’ailleurs à partir d'expérimentations que certains modèles émergent, comme Terre de liens dont nous avons interrogé une bénévole que nous nommerons Sophie. Cette association, née dans la Drôme il y a bientôt vingt ans, permet aux paysan.es porteurs de projets écologiques et variés, tel qu’à des collectifs où l'expérimentation sociale est en jeu, de se procurer des terres pour lancer leur projet. Leur politique est, à l'origine, de créer un mouvement massif d’organisation parallèle.En facilitant l’accès au foncier, elle bouscule les dépendances des nouveaux.velles agriculteur.ices à certaines institutions et leurs codes, comme la SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural). Par le biais de sa foncière, toute personne peut confier une partie de son épargne à Terre de liens , faisant d’elle une institutions parallèles : “nous avons un rôle de contrepouvoir, utile et complémentaire” précise Sophie.
Elle permet ainsi d’établir des liens entre les projets d’un même territoire et un réseau solide d’acteurs engagés, s’inscrivant dans une philosophie qui considère la terre comme un bien commun et non privé. Sophie, bénévole du groupe de la Drôme, précise leur “volonté profonde de permettre des projets ambitieux d’un point de vue écologique et social de se lancer”, ancrés sur le territoire grâce au travail réalisé en amont par les bénévoles. Terre de liens permettrait donc aux personnes qui s’installent de “trouver du sens dans leur métier”, offrant ainsi une possibilité de créer des modèles de projet hybrides et ambitieux sur le plan écologique.
Sur le même principe, mais avec une dimension bien plus locale et dans un moindre impact (par rapport à l’ampleur nationale de Terre de Liens qui a permit l’installation de nombreuses dizaines de fermes) l’association des Compagnons de la Terre, créée en 2006 « à l’initiative de salariés du CFPPA de Die avec le soutien de l’intercommunalité du Diois » [3] proposait aux paysans une « expérience pratique avant de se lancer et de se construire un réseau de connaissances pour leur faciliter l’accès au foncier ». Même si l’association n’existe plus aujourd’hui, nous sommes allés à la rencontre d’une ferme collective qui a pu voir le jour grâce à elle. L'Îlot 1000 feuilles regroupe une productrice de plantes à parfums, aromatiques et médicinales, deux bergères-fromagères (toutes en reconversion professionnelle), et un maraîcher. Partager ce terrain avait du sens pour elles.eux parce qu’ils ont une idée commune de ce que devrait être l’agriculture : aller vers plus d’agroécologie et travailler sur des petites surfaces. Les structures communes à ces trois entreprises - comme leur boutique sur place, ouverte les mercredis et le laboratoire de transformation - leur permettent de mieux rentabiliser l’espace. Nos entretiens dans cette ferme collective font écho aux valeurs communes que nous avons retrouvées chez les néo-agriculteur.ices que nous avons rencontré. Ils affichent une sincère volonté de défendre à la fois un respect du vivant et une logique d’inclusivité sociale par les prix solidaires et la vente directe au consommateur.ice, pour engendrer des modes de vie réellement plus écologiques qui répondent mieux aux besoins des habitant.es.
Pour conclure, derrière l’engouement académique autour de la Biovallée, nous avons observé sur le terrain une dissonance des discours qui remettent en cause la privatisation des ressources et la verticalité des modèles de gouvernance.
Nos entretiens témoignent de revendications politiques qui sortent des carcans de la compétitivité et prônent un autre type de développement territorial par la prise de pouvoir des citoyen.nes, la mise en place de structures et institutions parallèles, ou encore la mise en commun des moyens de production. Cependant, contrairement à ce que nous pourrions être tentés de faire, il serait inexact d’opposer de façon binaire deux vitesses de la transition écologique dans la Vallée.
Même si des représentations différentes ont mené à des conflits politiques et juridiques (dont le symbole est le climat de tension autour de l’habitat léger), celles-ci se croisent aussi. Nous l’avons notamment remarqué par l’appartenance de certain.es acteur.rices à différents projets ou faisant partie de plusieurs associations. Par exemple, Guillaume est à la fois adhérent de la BioVallée et co-créateur de Serendip, qui pourtant n'ont pas les mêmes objectifs.
De plus, certaines associations sont soutenues par Bio Vallée depuis le début et pourtant sont critiques sur leurs sources de financements ou sur leur vision écologique qu’elles considèrent dépassée. C'est donc, malgré certaines critiques, finalement un climat d’entraide et de bienveillance plutôt que de conflit qui en ressort. Les acteur.rices semblent préférer la multiplicité des formes de changement à l’imposition d’un seul modèle qui serait le bon.
Il faut retenir que de nombreux liens et de réseaux ont pu s’établir entre les différents projets de la Vallée, car ce territoire est ouvert au changement et que cette dynamique a participé à développer de nouvelles représentations et même à schématiser des réseaux d’interactions entre les projets pour créer une forme de résilience locale. Mais cette dernière passe avant tout par un engagement citoyen initial.
Nos conclusions
Puissant outil de mobilisations citoyennes, le mouvement des initiatives de transition cherche à construire un mouvement écologique solide par l’action “par le bas”, plutôt que de miser sur un programme politique imposé “par le haut” et par les partis politiques gouvernementaux, pour un changement systémique global et radical (à l’instar de Rob Hopkins et le mouvement des villes en transition). S’il s’agit avant tout de retrouver la puissance du niveau d'action local pour redonner confiance et capacité d'action aux citoyen.ne.s, cela peut cependant comporter des risques dans la manière de concevoir l’action politique écologique collective.
Sur le territoire de la Biovallée, ces initiatives sont nombreuses et nous sommes allé.es à la rencontre de certaines d’entre elles. Elles se situent dans des secteurs différents : éducation (L’université des Alvéoles), agriculture (L'Îlot 1000 feuilles, Oasis de Serendip), habitat collectif (Château Pergaud), lieux collectifs (Les Jardins de Samare), acteur.rices associatif d’aide au développement (Terre de lien, association Biovallée) et institutionnels (CCVD). L’histoire de ce territoire et sa nature en ont fait un terreau fertile pour l’émergence de celles-ci et d’une culture écologique commune, bien que cette dernière ne soit pas homogène.
Cependant, nous portons une attention à l’aspect dépolitisé de certaines initiatives qui se contentent d’un rôle de "construction", évitant tout conflit politique avec les acteur.ices qui ne partagent pas leur vision écologique et manquent de réelles revendications sociales et anticapitalistes pour une écologie inclusive des classes populaires et qui lutte contre les causes de la crise écologique dont les industries poussés par le profit sont la figure de proue. Ce manque d’alliance entre initiatives locales de transition et politisation comporte un danger : “c’est bien le projet néolibéral qu’elles pourraient involontairement contribuer à renforcer par leur parti pris d’atténuation des conflits” [5], notamment dans la stratégie de ce dernier de réduction massive et de privatisation des services publics, dans un contexte de compressions budgétaires. Comme le montre Luc Botlanski, dans “Le nouvel esprit du capitalisme” (1999), les nouvelles stratégies néolibérales se cachent sous les politiques de “focusing on localism". En prétendant rendre le pouvoir aux communautés locales et mettre en avant le principe de subsidiarité, l’Etat peut se donner un gage de désengagement.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la capacité des initiatives locales de transition à inclure les populations exclues de ce phénomène, notamment par des niveaux de capitaux culturels et sociaux inégaux. Par exemple, la plupart des associations interrogées attirent peu les populations issues de l’immigration, qui habitent pourtant les mêmes communes. Aucune personne que nous avons interrogée, même la plus engagée, n’a pu apporter de réponses face à cette barrière érigée entre des modes de vie et sociabilités incompatibles, mis à part la nécessité d’un changement de paradigme par une éducation populaire aux enjeux écologiques touchant les modes de consommation et d’alimentation.
De plus, le territoire de la Biovallée, en s’inscrivant dans les cadres de la compétitivité et attractivité entre les territoires ne peut pas faire figure d’exemple de reproductibilité mais au contraire est une exception dont l’émergence a en partie eu lieu grâce à certaines aides exceptionnelles extérieures, dans une volonté de se démarquer des autres territoires, non pas de coopérer avec eux. Les effets de cette compétitivité entraînent aussi une hausse des loyers, une gentrification, face à laquelle certains de nos interlocuteur.ices nous ont confié une détresse qui nécessiterait à minima un besoin de souplesse et d’adaptation du droit concernant les autres formes d’habitats. Ainsi, une contradiction se dévoile : en s’inscrivant dans une logique compétitive, le territoire nuit aux habitants qui participe à la création de cette compétitivité.
Ce qui ressort de nos interviews est que le rôle de l’action publique ne doit pas consister à diriger les initiatives mais bien à “créer un climat favorable à leur émergence et accompagnement” (Biovallée). Les acteurs publics pourraient davantage soutenir les petits producteur.rices par des financements en réformant la PAC (Politique Agricole Commune) ; par l’acheminement en eau qui manque terriblement dans la région; alors de la création des PAT (Projet Agricole Territorial) ; avec des formations; de la sensibilisation des jeunes etc., ou encore penser à lancer un mouvement de fermes communales achetées par les collectivités, comme le propose une bénévole de Terre de Liens.
[1] Bottom up (de bas en haut) et top down (de haut en bas) désignent, en politiques publiques, deux modalités de gouvernance : ces anglicismes tendent à remplacer dans le jargon politique et économique leurs équivalents « descendant.e » et « ascendant.e »; la première reflétant une conception plus traditionnelle du pouvoir; la seconde visant plutôt le développement d’initiatives citoyennes http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/top-down-et-bottom-up
[2] “une décrue du torrent de la croissance ; mais plus concrètement (...) il s’agit implicitement ou explicitement d’en revenir à un niveau de la vie matérielle compatible avec la reproduction des écosystèmes”, LATOUCHE Serge, « Introduction. Origine et sens », dans : Serge Latouche éd., La décroissance. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2022, p. 3-22. URL : https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/la-decroissance--9782715409606-page-3.htm >>> lien vers ressources bibliographiques lé décroissance de serge latouche
[3] Thèse de Sibylle Bui (Agro Paris Tech, https://www.theses.fr/158308573
[4] Site internet « Sagacité » : http://sagacite.caprural.org/story_html5.html?fbclid=IwAR3a7OPeBNWy4prVzMP4fp11N_YqUR0BqmiV_ARqh4n3SIY9qeTwIJ1GLSo
[5]INITIATIVES DE TRANSITION : LA QUESTION POLITIQUE Christian Jonet, Pablo ServigneLa Découverte | « Mouvements », 2013 https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-3-page-70.htm
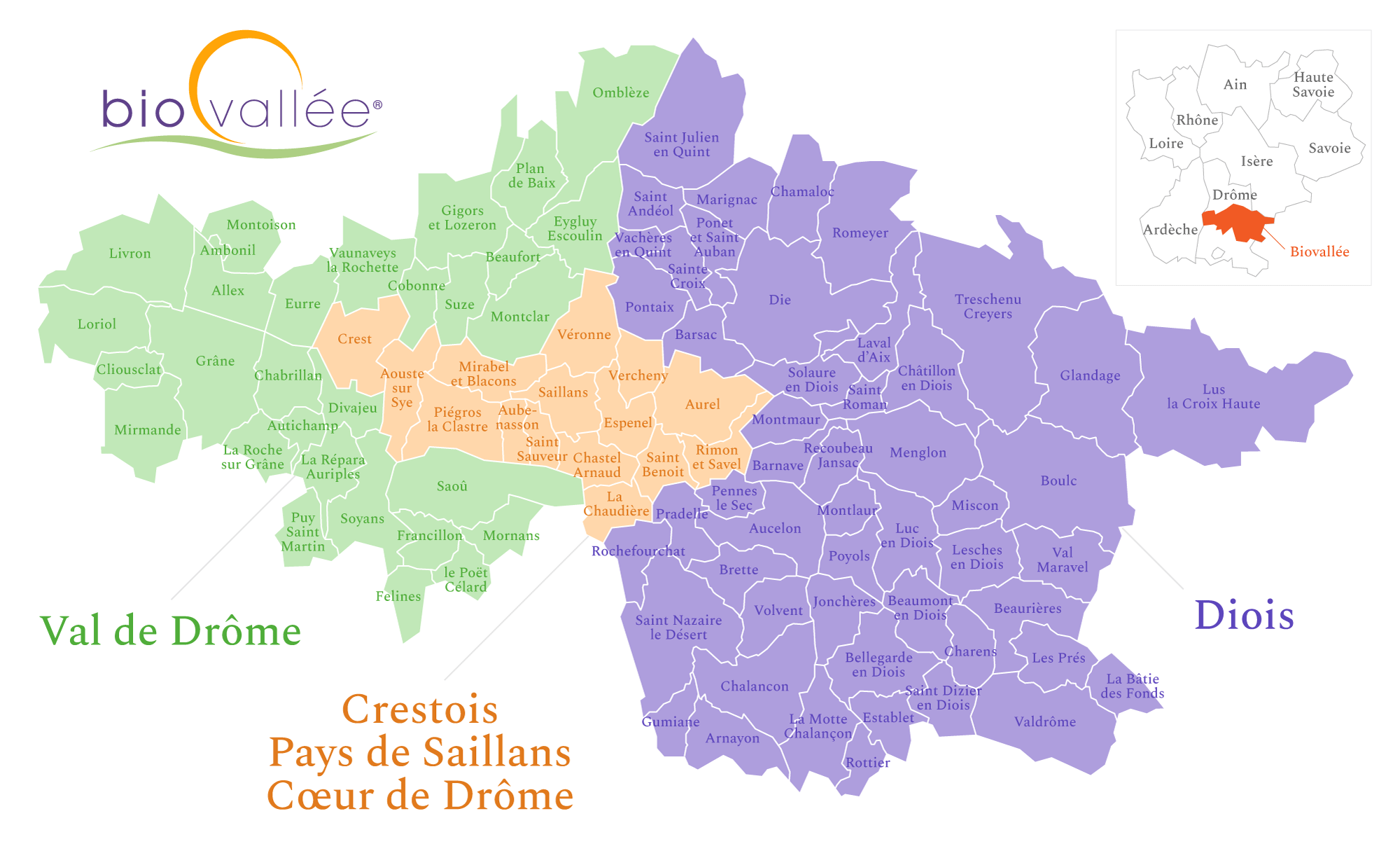
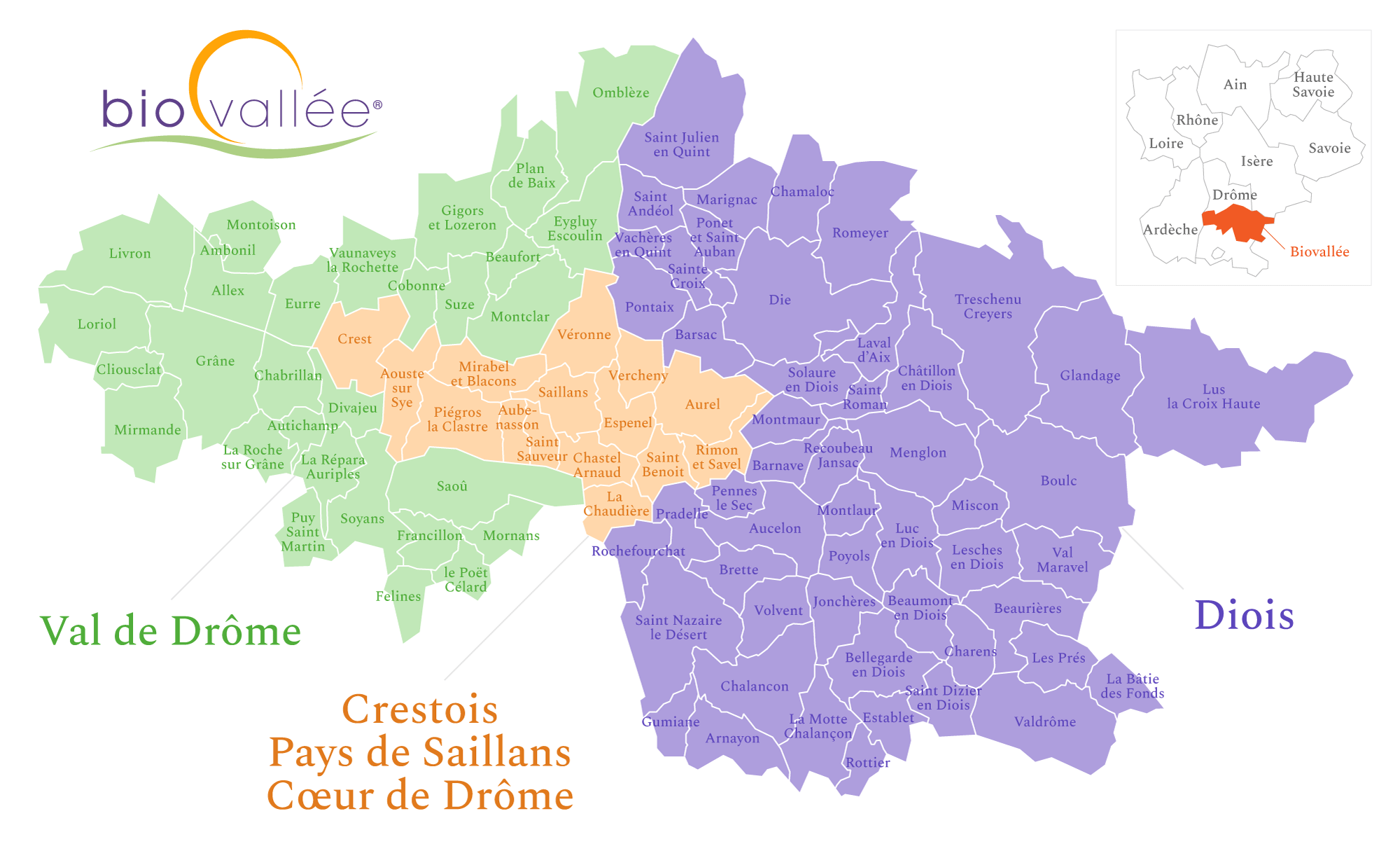
Bien connue par les locaux et même au-delà, la guinguette d’Aouste-sur-Sye nous avait été conseillée par Martin, un jeune architecte que nous avions rencontré à Jabrezad en Ardèche: il nous évoquait l’ambiance particulièrement festive et les afters techno qui suivaient la soirée. Nous nous y sommes rendus et la découverte était à la hauteur de nos espérances : concert de rock, bières, et danseur.euse.s de tout âge, nous sommes rentré.e.s impressionné.e.s par l’ambiance de ce village d’un peu moins de 2500 habitants.
La Drôme est en effet connue pour son dynamisme à la fois culturel et écologique, pour sa « biovallée » située sur un territoire rural. Le collectif Ville et Décroissance, dont Rosalie faisait partie à Sciences Po, lui avait consacré un article en 2019, que nous avions lu, et qui avait renforcé notre curiosité à son propos. Surpris.es de lire qu’une alliance et une cohésion semblait bien réelle au sein de cet “eldorado”, nous nous sommes interrogé.e.s sur le fondement de cette impression et avons choisi de nous rendre sur place. Afin de rencontrer le plus d’acteur.rices possibles, nous avons décidé de faire une pause dans notre aventure d’autostoppeur.euse.s pour prendre la voiture d’Agathe et être libres de nous rendre où notre enquête nous mènerait. Toutes nos rencontres ont bien évidemment été anonymisées, les noms changés, pour respecter la vie privée des individus.
Ces questionnements sur l’émergence d’une telle dynamique s’inscrivent dans une démarche globale de remise en question des modèles plus classiques de développement territorial. Les études de sciences politiques que nous avons faites et notamment d’urbanisme (Agathe et Rosalie), au cours desquelles nous avons étudié les politiques d’aménagement du territoire, ont été des ressources pour mieux comprendre les logiques présentes et passées du territoire, mais aussi une source de désespoir ou découragement. Face aux enjeux climatiques, les politiques urbaines actuelles menées au niveau national et européen brandissent l’attractivité du territoire et la compétitivité comme étendards favorisant les investissements, la venue des cadres supérieurs et des touristes. Elles s’inscrivent dans des logiques de « croissance verte » et des objectifs de « développement durable » qui sont loin d’être à la hauteur… Même si le thème de l’urgence écologique est aujourd'hui largement abordé par les politiques urbaines mainstream, à l’instar des villes résilientes, villes zéro-carbone ou des politiques de verdissement urbain, nous restons souvent sceptiques quant à leur réelle efficacité (réduction des émissions de gaz à effet de serre sans prendre en compte nos modes de consommation ou les 8 autres limites planétaires) et à leur inclusivité sociale (péage urbain contre l’utilisation de la voiture, vignette contre les vieilles voitures polluantes, etc.).
À cette vision de l’écologie via la croissance verte nous opposons l’idée que ces politiques devraient urgemment être guidées par l’intérêt de l’environnement et de la population, par la redéfinition de nos modes de vie et de nos rapports au vivant, par l’exploration et la réalisation d’imaginaires collectifs moins individualistes, par la réduction de la production, par des politiques urbaines prenant en compte qu’il faudra se débarrasser des causes de la crise écologiques (grandes industries, investissement à fort impact environnemental, etc.). Ces politiques urbaines alternatives sont conçues selon une logique bottom-up [1] et abandonnent les logiques marchandes pour d’autres vecteurs d’organisation œuvrant avant tout pour les couches populaires déjà présentes dans les villes.
Dans la vallée de la Drôme, la Biovallée est constituée de trois communautés de communes :Val de Drôme en Biovallée (appelée CCVD) rassemble 29 communes et 30400 habitants, Le Crestois et Pays de Saillans rassemble 15 communes et 15700 habitants, et le Diois rassemble 50 communes et 11 900 habitants. Sur le territoire de la Biovallée, la part des surfaces cultivées en agriculture biologique est six fois plus importante qu’au niveau national : 32 % contre 5 %. Elle est devenue un territoire d’expérimentation sur plusieurs niveaux : agriculture, politique, expérience démocratique, éducation (alternative), réseau locaux d’entraide, etc. Cela a fait d'elle un « laboratoire d'expérimentations », qui est beaucoup étudié et considéré aujourd’hui comme un modèle dans le milieu académique. L’association Biovallée souhaite à ce propos faire de son territoire un exemple de réussite pour la gestion et la valorisation des ressources, et par le développement de l’ écologie et dans l' économie locale et durable. Rappelons cependant l’hétérogénéité du département de la Drôme, qui contient certains territoires très enclavés et dont les disparités démographiques et socio-économiques sont importantes. Nous nous prononçons donc seulement sur la partie du Val de Drôme que nous avons visitée!
Pour découvrir ce territoire nous avons été accueillis par une proche d’Agathe à Aouste sur Sye (Cf carte ci-dessous).
Pour mener cette étude, nous sommes allé.es à la rencontre d’acteur.rices, d’initiatives locales qui rompent avec les stratégies de décisions top-down classiques (soit provenant d’entités politiques et administratives sans concertation de la société civile et de la population locale), afin de nous intéresser aux conditions de l’émergence de scenarii d’adaptation à la crise écologique sur un territoire.
Dans cette étude, nous questionnons la prise en compte des particularités locales et des implications des habitant.es du territoire par ces initiatives. Il est important de préciser que le rôle de telles initiatives locales ne doit aucunement remplacer une offre de service public, le risque étant de justifier un retrait de la puissance publique et des financements qui l’accompagnent.
Notre objectif ici est d’analyser ces initiatives en montrant les liens qui existent entre les acteur.rices, et les limites du pouvoir d’action de chacun d’entre elles.eux.
Cette étude s’inscrit dans une démarche globale de remise en cause du capitalisme vert et de ses “promesses” de l'euphémisme croissance durable [2]. Nos lectures et connaissances accumulées sur de nombreuses théories de l’écologie sociale, les approches libertaires et locales de l’écologie, la décroissance sont pour nous des repères pour comprendre les manières dont un monde écologique pourrait/devrait advenir. Nos questionnements porteront sur les processus socio-historiques qui expliquent les conditions d’une conscience écologique collective, les complexités et interdépendances qui font vivre le territoire, ainsi qu’un tel dynamisme sur le territoire.
Un terreau fertile pour l'émergence d'initiatives locales, écologiques et sociales
Une dynamique historique : vers l'émergence d’une culture commune ?
Nous avons voulu interroger l'émergence de la dynamique actuelle de la vallée de la Drôme et du foisonnement d'initiatives locales de transition écologique et sociale qui caractérisent ce territoire. Son dynamisme puise notamment sa source dans le fait d’être historiquement une terre d'accueil : on note une longue tradition d’ouverture à la diversité sur le territoire en tant que lieu de passage d’une route marchande descendant vers l’Italie, son accueil de protestants, puis de républicains espagnols durant la guerre civile espagnole puis de groupes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale (maquis du Vercors et en Drôme Sud). Puis arrivent dans les années 1970 des “pionniers” (comme les surnomme Michèle de l'association Biovallée), venus des Pays-Bas, de Suisse ou d’Allemagne ainsi que de nombreuses personnes issues de la génération “soixante-huitards”. Avec des idéaux de retour à la terre et d’une recherche d’autonomie, et dans un contexte où l'exode rural s'intensifie, ils.elles rencontrent l’engouement des natifs de voir un renouveau émerger sur leur territoire : les locaux perçoivent alors en grande partie ces arrivées comme un moyen de re-dynamiser leur territoire rural qui se vide à cette époque.
Aussi, dans les années 1980, une collaboration territoriale pionnière a marqué la vallée lors de la dépollution de la rivière Drôme, fortement dégradée par les décharges à l’air libre, le déversement de produits chimiques, etc. Cet épisode a créé une forte cohésion sociale entre les différentes collectivités locales ayant œuvré ensemble vers un objectif commun de “rendre la rivière baignable”, instaurant ainsi une dynamique collective de “développement durable” et leur valant le prix Riverprize.
Par ailleurs, les perspectives d’agriculture intensive, particulièrement en vogue à cette période avec les stratégies gouvernementales de modernisation de l’agriculture (accentuées à la suite de la Seconde Guerre Mondiale puis dans les années 1960 et 1970s), n’ont pas trouvé leur écho sur un territoire marqué par la relative pauvreté des sols, le relief et la petite taille des parcelles agricoles. Dans ce contexte territorial particulier, et d’installation de pionnier.e.s aux idéaux novateurs, l'agriculture s’est rapidement attachée à la diversification des activités “innovantes”, biologiques, de petites exploitations. Le développement de la filière bio et des plantes aromatiques et médicinales (filière PAM plantes aromatiques & médicinales, avec notamment l’Herbier du Diois, créé en 1989 par les familles hollandaises Wartena et Vink) ont vite été une opportunité pour différencier l’agriculture drômoise et en faire une agriculture alternative “de qualité”, qui renforça l’identité territoriale. D’ailleurs, dès 1987 on peut voir que l’environnement est pris en compte dans la charte intercommunale du Val de Drôme. C’est ainsi que la marginalisation des défenseur.euses du bio a commencé à s’éroder , jusqu’à ce que le bio deviennent fer de lance d’une stratégie territoriale clairement affichée.
Petit à petit, toutes ces dynamiques structurent et ancrent un modèle de développement durable, terme encore largement utilisé à cette époque, sur le territoire. Hugues Vernier, de la CCVD, nous parle d’une “approche agricole du territoire”, avec une vision globale de la vie agricole, précisant: “la force de la biovallée est d’avoir eu ce discours et cette démarche (de qualité environnementale) avant les autres” (H.Vernier). Le développement important des connaissances autour de l’agro-écologie* dans la vallée découle de cette approche agricole spécifique du territoire, et a contribué à la dynamique commune décrite.
Ainsi, si "l'action publique est vouée à l’échec aussi longtemps qu’elle néglige de tenir compte de ce ciment qui “fait” la communauté" (De Shutter, 2016), ces différentes spécificités du territoire drômois ont pu contribuer à construire un récit commun ayant pour finalité de faire converger les intérêts de la population.
La dynamique drômoise, notre ressenti
Globalement, nous avons pu constater l'existence d’une forme de culture commune sur le territoire et chez les habitant.e.s, une ambiance générale palpable qui se retrouve dans toutes les initiatives que nous avons pu rencontrer - depuis les pédagogies alternatives visant à passer par l’éducation et la formation (avec le système de Bio Vallée Territoire Apprenant*, la dimension formative de l’Université des Alvéoles, etc.) jusqu’à l’organisation politique avec l’expérience démocratique de la République de Saillans, en passant par l’organisation de circuits courts sur le territoire (soutenue par l’association Agri Court ou les différentes initiatives de vente directe) ou encore les expériences de collectivisation des habitats ou des terres (à l’instar des jardins de Samare et sa gestion collective du potager, ou les oasis de Serendip et d’Alegria).
On observe ainsi une forte dynamique du secteur associatif, d’initiatives à la gouvernance horizontale ainsi qu’un réseau d’acteurs vertueux mettant l'accent sur l’entraide plutôt que sur la compétition, dans une région où l'on recense deux fois plus d’emplois dans le secteurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) par rapport à la moyenne du reste de la France.
Ainsi, si 40% des agriculteurs sont certifiés bio dans la vallée, ce n’est pas par hasard : une influence diffuse est exercée par la dynamique collective propre au territoire depuis 30 ans, tant chez les consommateurs.rices que chez les producteurs.rices ainsi que chez les citoyens.ennes. La “Biovallée”, la vallée du vivant, est certainement parvenue d’une certaine manière et à un moment donné à “faire système” avec son soutien à une dynamique pionnière de transition. Il semblerait avant tout que ce soient plusieurs dynamiques qui s’auto entretiennent et s’alimentent, venant d’une approche “bottom-up”** des acteur.rices locaux ainsi qu’une approche plus descendante ou top-down** entretenue par les pouvoirs publics. Selon les personnes que nous avons rencontrées sur le terrain, au delà d’une biovallée qui servirait plutôt à attirer des financements dont ils.elles ne voient pas forcément la couleur, notamment selon une agricultrice que nous avons interrogé, elle regrette de ne pas en voir davantage l’impact concret sur son territoire.
Malgré tout, le récit commun émerge et s’entretient avant tout par le fait de vivre sur un même territoire, se côtoyer et “se pétrit, se malaxer, se raconter des histoires, des rêves" (Samuel). Ainsi, cette construction en vue d'intérêts communs se fait par des acteurs.rices étant partie prenante d’une même dynamique territoriale, favorisant ainsi la coopération plutôt que la concurrence.
Une population demandeuse, une implication initiale des individus
Ce terreau réserve ainsi aux agriculteurs.rices bio un sort plus favorable qu’ailleurs, bien qu’il ne soit pas tout rose, grâce à une sensibilisation particulière des habitant.e.s qui joue sur leurs pratiques de consommation et sur leur organisation commune locale, ainsi qu’aux marchés. Par exemple, le Mimi Marché, d’initiative citoyenne, permet une rencontre directe et un dialogue hebdomadaire producteur.e-habitant.e. Les initiatives permettant la vente directe des producteur.rices aux consommateur.rices (telles les épiceries bio coopératives La Carline, l’Epicerie Géniale) limitent le chantage par les prix et les effets néfastes de la grande distribution sur les producteur.ices tout en étant plus représentatives du travail consacré. L’existence de l’association Agribiodrôme est tout aussi importante car elle accompagne, depuis 1987, les collectivités dans leurs projets de développement de l’agriculture biologique comme Agri Court, qui crée des circuits courts pour la production agricole locale. Ces initiatives et cette dynamique globale permettent ainsi une répartition plus équitable de la valeur économique chez les agriculteur.rice.s. Nous avons donc compris que l'émergence de cette culture partagée consiste en un cercle vertueux entre consommation et production sur le territoire, avec une population demandeuse et des agriculteur.rice.s qui sont soutenus pour se tourner vers des voies relevant davantage de l'agroécologie.
Un manque d’inclusivité sociale
Pourtant, ces dynamiques sont à largement nuancer car on rencontre un réel problème d'exclusivité sociale que nous résumons en deux points. D’une part, toutes les personnes rencontrées nous ont fait part du problème de la hausse des loyers et du foncier dans la vallée, obligeant des locaux à s’éloigner de plus en plus et requérant un certain capital économique pour rejoindre la région. D’autre part, nous nous sommes rapidement rendus compte de l’existence d’une “majorité silencieuse” et de plusieurs profils sociologiques sur le territoire qui ne se croisent pas, créant ainsi une forme d’entre-soi de la “classe écologique et alternative”, et alimentant ainsi des oppositions et divergences d’opinions. En guise d'exemple, la somme du ticket d’entrée (15 000€) pour intégrer le collectif du Château Pergaud ou encore le prix d’une agriculture biologique et locale par rapport au top-budget de Lidl, est représentatif de cette difficulté d’accès lorsque l’on est dans une situation de précarité économique.. Ainsi, une résilience écologique ne pourra pas être atteinte si une grande partie de la population n’a pas les moyens d’en être partie prenante. C’est pourquoi si cette lutte écologiste ne se couple pas avec une lutte sociale, elle aboutit à un renforcement des inégalités. C’est pourquoi un mouvement enthousiaste d'initiatives de transition n’est pas sans danger d’un point de vue social lorsque ces dynamiques deviennent apolitiques et abandonnent les idées de lutte collective et de revendication sociale.
Aujourd’hui, pourtant, face à l’urgence écologique, il semblerait que la région se “repose sur ses lauriers”, (selon certaines personnes interviewées) avec cette image désirable de pionnière datant d’il y a 20 ans, sans forcément se renouveler pour aller plus loin que les logiques d’un ancien paradigme. Les pouvoirs locaux ne sont pas encore forcément ouverts aux habitats légers par exemple, et ne vont pas jusqu’à une dynamique de bio régionalisme qui instaurerait une véritable remise en question de la trajectoire étatique et capitaliste. C’est ce que nous allons tenter de questionner ci-dessous.
Des logiques hétérogènes sur le territoire
Derrière un récit qui semblerait commun concernant la BioVallée, nous avons rencontré des visions plus ou moins radicales sur les objectifs de « transition écologique » ou « rupture écologique ». Nous avons rencontré des associations aux organisations et visions très différentes ; du Jardin de Samare prônant une vision politique engagée à la Biovallée défendant des actions davantage institutionnelles. Nous avons compris que des discours distincts se retrouvent derrière l'objectif « bio » de la vallée. D’un côté, certaines entreprises se sont tournées vers le bio et ont exporté leur production à un niveau national et international, et de l’autre, des initiatives ont toujours lutté pour un retour vers le local et/ou davantage d’horizontalité dans les organisations. Nous avons donc analysé les modèles d’actions des différents acteur.ices pour comprendre leur projet pour le territoire.
Du bio pour des objectifs de compétitivité
Comme nous l’avons précisé plus haut, dans le domaine de l’agriculture, le Diois est devenu une figure de territoire leader de l’agriculture biologique dans les années 2000, et le Val de Drôme a suivi l’exemple, afin que le bio soit une locomotive du territoire pour les entreprises et les consommateur.ices. L’agriculture biologique, d’abord considérée comme marginale, s’est entre autres développée dans un contexte de plus en plus concurrentiel et est apparue comme “une solution pour maintenir des outils coopératifs sur lesquels les agriculteurs gardent la main”[3], garantissant aux agriculteur.rice.s et aux entreprises de rester “compétitifs”, et aux communes une certaine “attractivité”.
Prenons l’exemple de la filière PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) qui s’est fortement développée dans la vallée. Le savoir-faire unique des producteur.rice.s locaux et les variétés de plantes du territoire ont permis d’avoir des produits de qualité. Les néo ruraux, venant principalement du nord de l’Europe, ont trouvé une niche dans laquelle se développer, dans une logique d’exportation, comme Rodolphe Baltz qui a lancé Sanoflore. Le développement des entreprises de transformation sur place a notamment permis une expansion industrielle. L’hybridation des savoirs des néo ruraux - n’ayant aucune connaissance dans le domaine des plantes mais dans la commercialisation et le marketing territorial - et des paysans sur place - comme les savoir-faire traditionnels de distillation - a donc contribué à déployer le bio sur le territoire.
Cette dynamique a été renforcée par un contexte institutionnel de marketing territorial autour du développement du bio.
En 2002, le département et la CCVD (Communauté de Communes du Val de Drôme) ont créé la marque ‘Biovallée’, mais il faudra attendre 2012 pour la création de l’association du même nom, chargée de la gestion et de la promotion de la marque, dans l’objectif de gagner en visibilité et avec l’ambition de devenir un éco-territoire de référence en Europe. Le but de l’association est la mise en commun des ressources par des acteur.rice.s d’un même territoire, en vue de les économiser, de les réutiliser ou d’en améliorer l’usage face aux besoins : par exemple le partage d’infrastructures, d’équipements, etc.
Ces objectifs nécessitent des financements qui ont, entre autres, été apportés par le dispositif régional Grands Projets Rhône-Alpes (GPRA): la Biovallée disposa de 10 millions d’euros dès 2009 ayant aidé à l’émergence de 191 actions locales. Cependant, ces subventions présentent une certaine fragilité : l'arrêt des financements en 2015 et le manque d'intérêts des intercommunalités pour continuer de coopérer a mené à une crise de gouvernance de l’association Biovallée. Pour y remédier, cette dernière a participé au programme Territoire d'Innovation dès 2018 (géré par la Banque des Territoires, dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir de l’État) afin de remobiliser les acteur.rices et dépasser les freins politiques. 12,8 millions d’euros ont ainsi été versés à cinq entreprises et 5,7 millions à quinze actions différentes sous forme de subventions. Alors même que les retombées réelles de ces fonds cités de l’association ne sont pas objectivées et déclarées aux acteur.rice.s du territoire, certaines associations et collectifs s’interrogent sur les intérêts économiques et la visée d’attractivité de la marque.
Mais l’importance donnée au développement économique autour du bio et les logiques d’attractivité des dernières années sont-elles réalistes face aux enjeux environnementaux ?
Ces stratégies ont attiré des opérateurs de plus en plus nombreux et puissants économiquement (Duffaud-Prevost, 2015) comme L’Oréal et Yves Rocher. Bien qu’ayant aidé à construire une identité territoriale, ces entreprises ont poussé à une mise en compétition entre les acteur.rice.s de la filière PPAM - la logique de coopérative n’a pas duré à cause de cela malgré les efforts de Biovallée - et à une dépendance à des capitaux étrangers, dans une logique productiviste [4].
Ainsi, ce développement territorial s’inscrit dans des logiques de compétitivité et d’exportation, bien différentes des discours que nous avons pu entendre en interrogeant les acteur.rice.s que nous avons rencontré et qui ont à cœur la qualité de vie des habitant.e.s du territoire. Ces acteur.rice.s, ne s’inscrivant pas seulement dans le secteur agricole, promeuvent un mode de vie davantage écologique par des nouvelles pratiques de sensibilisation, de formation, de commercialisation et d’interaction avec la société.
Leurs buts : limiter le coût environnemental des transports par une dynamique plus territorialisée, lutter contre la hiérarchisation menant à l’exploitation des travailleur.euse.s et du sol ainsi que défendre le développement d’un réseau d’entraide.
Émergence d’une culture écologique radicale…
D’un point de vue historique, on voit l’émergence d’une culture écologique plus radicale par la société civile elle-même (Bui, 2015). Par exemple, la Carline, coopérative créée en 1989 - regroupant des bénévoles cherchant à l’origine à promouvoir le bio - s’attelle à la tâche de remplacer les produits de grossistes par des produits locaux. Cette initiative citoyenne prend de l’ampleur avec le temps : « la Carline passe de 250 à plus de 600 familles adhérentes entre 2002 et 2008 » (site de la Carline). D’après leur site, ils.elles se définissent comme une « coopérative dirigée par son écosystème. Ici, pas de patron, ni d’actionnaire : La Carline appartient aux citoyen.e.s ayant achetés des parts sociales », et tente d’échapper au modèle classique de l’entreprise. Elle vise donc à promouvoir les circuits courts, tout comme l'association Agri Court que nous avons rencontré qui met en lien les agriculteur.rice.s et les client.e.s (majoritairement de la restauration collective). La juste rémunération des producteur.rice.s et la prise en compte de leur structure sont des valeurs fondamentales qu’Agri Court souhaite respecter « quitte à rogner les marges », comme nous le présente la responsable relation producteurs. Jeune diplômée ingénieure ayant quitté son travail en ville pour “retrouver du sens dans son activité professionnelle” , elle nous confie apprécier ses missions et son environnement de travail. Elle ajoute qu’ici la fin de l’année, l’association a pour but de devenir une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), un statut juridique “prenant en compte chacune des parties prenantes et permettant d’améliorer la gouvernance”.
Au-delà de la mobilisation citoyenne, on retrouve donc dans la vallée des associations qui se professionnalisent dans la transition écologique et sociale. Ces initiatives sont le symbole de domaines créateurs d’emplois qualitatifs, dont les structures sont plus horizontales que dans des entreprises classiques.
Une perception différente de la temporalité et de la radicalité de la transition est clairement visible par rapport à la vision détaillée dans un premier temps, notamment concernant la remise en question du modèle entrepreneurial et la dépendance aux cadres classiques, perception initiée par des initiatives plus radicales. Cela soulève la question de la dépendance au modèle classique de l’entreprise pour un développement local et du bénéfice qu’en retirent les habitant.es déjà présent.e.s.
Alors, qu'en est-il des revendications politiques ?
Certaines initiatives telles que les Jardins de Samare défendent un idéal démocratique et social. Cette association, pilotée par deux jeunes locaux, a transformé un terrain en friche depuis vingt ans en jardin autogéré où est appliquée la “politique par la pratique” grâce à la mise en commun des terres et la mutualisation des biens (outils, eau, etc). Sont organisés, entre autres, des journées plantation, des cours avec des élèves de l’école primaire de la commune, des évènements culturels, des ateliers les dimanches etc. pour permettre un partage des compétences et des savoirs entre bénévoles. Leur but est de former une communauté d’apprenants en leur redonnant des bases solides et de la confiance en leurs talents manuels. Cette initiative permet une éducation et une sensibilisation qui touchent plusieurs générations, mais crée surtout un espace de débat citoyen. Même si elle n’a pas d’objectif nourricier, les bénévoles défendent qu’« il faut de la diversité de modèles pour permettre l’expérimentation ».
…jusqu’à l’organisation d’institutions sociales parallèles !
C’est d’ailleurs à partir d'expérimentations que certains modèles émergent, comme Terre de liens dont nous avons interrogé une bénévole que nous nommerons Sophie. Cette association, née dans la Drôme il y a bientôt vingt ans, permet aux paysan.es porteurs de projets écologiques et variés, tel qu’à des collectifs où l'expérimentation sociale est en jeu, de se procurer des terres pour lancer leur projet. Leur politique est, à l'origine, de créer un mouvement massif d’organisation parallèle.En facilitant l’accès au foncier, elle bouscule les dépendances des nouveaux.velles agriculteur.ices à certaines institutions et leurs codes, comme la SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural). Par le biais de sa foncière, toute personne peut confier une partie de son épargne à Terre de liens , faisant d’elle une institutions parallèles : “nous avons un rôle de contrepouvoir, utile et complémentaire” précise Sophie.
Elle permet ainsi d’établir des liens entre les projets d’un même territoire et un réseau solide d’acteurs engagés, s’inscrivant dans une philosophie qui considère la terre comme un bien commun et non privé. Sophie, bénévole du groupe de la Drôme, précise leur “volonté profonde de permettre des projets ambitieux d’un point de vue écologique et social de se lancer”, ancrés sur le territoire grâce au travail réalisé en amont par les bénévoles. Terre de liens permettrait donc aux personnes qui s’installent de “trouver du sens dans leur métier”, offrant ainsi une possibilité de créer des modèles de projet hybrides et ambitieux sur le plan écologique.
Sur le même principe, mais avec une dimension bien plus locale et dans un moindre impact (par rapport à l’ampleur nationale de Terre de Liens qui a permit l’installation de nombreuses dizaines de fermes) l’association des Compagnons de la Terre, créée en 2006 « à l’initiative de salariés du CFPPA de Die avec le soutien de l’intercommunalité du Diois » [3] proposait aux paysans une « expérience pratique avant de se lancer et de se construire un réseau de connaissances pour leur faciliter l’accès au foncier ». Même si l’association n’existe plus aujourd’hui, nous sommes allés à la rencontre d’une ferme collective qui a pu voir le jour grâce à elle. L'Îlot 1000 feuilles regroupe une productrice de plantes à parfums, aromatiques et médicinales, deux bergères-fromagères (toutes en reconversion professionnelle), et un maraîcher. Partager ce terrain avait du sens pour elles.eux parce qu’ils ont une idée commune de ce que devrait être l’agriculture : aller vers plus d’agroécologie et travailler sur des petites surfaces. Les structures communes à ces trois entreprises - comme leur boutique sur place, ouverte les mercredis et le laboratoire de transformation - leur permettent de mieux rentabiliser l’espace. Nos entretiens dans cette ferme collective font écho aux valeurs communes que nous avons retrouvées chez les néo-agriculteur.ices que nous avons rencontré. Ils affichent une sincère volonté de défendre à la fois un respect du vivant et une logique d’inclusivité sociale par les prix solidaires et la vente directe au consommateur.ice, pour engendrer des modes de vie réellement plus écologiques qui répondent mieux aux besoins des habitant.es.
Pour conclure, derrière l’engouement académique autour de la Biovallée, nous avons observé sur le terrain une dissonance des discours qui remettent en cause la privatisation des ressources et la verticalité des modèles de gouvernance.
Nos entretiens témoignent de revendications politiques qui sortent des carcans de la compétitivité et prônent un autre type de développement territorial par la prise de pouvoir des citoyen.nes, la mise en place de structures et institutions parallèles, ou encore la mise en commun des moyens de production. Cependant, contrairement à ce que nous pourrions être tentés de faire, il serait inexact d’opposer de façon binaire deux vitesses de la transition écologique dans la Vallée.
Même si des représentations différentes ont mené à des conflits politiques et juridiques (dont le symbole est le climat de tension autour de l’habitat léger), celles-ci se croisent aussi. Nous l’avons notamment remarqué par l’appartenance de certain.es acteur.rices à différents projets ou faisant partie de plusieurs associations. Par exemple, Guillaume est à la fois adhérent de la BioVallée et co-créateur de Serendip, qui pourtant n'ont pas les mêmes objectifs.
De plus, certaines associations sont soutenues par Bio Vallée depuis le début et pourtant sont critiques sur leurs sources de financements ou sur leur vision écologique qu’elles considèrent dépassée. C'est donc, malgré certaines critiques, finalement un climat d’entraide et de bienveillance plutôt que de conflit qui en ressort. Les acteur.rices semblent préférer la multiplicité des formes de changement à l’imposition d’un seul modèle qui serait le bon.
Il faut retenir que de nombreux liens et de réseaux ont pu s’établir entre les différents projets de la Vallée, car ce territoire est ouvert au changement et que cette dynamique a participé à développer de nouvelles représentations et même à schématiser des réseaux d’interactions entre les projets pour créer une forme de résilience locale. Mais cette dernière passe avant tout par un engagement citoyen initial.
Nos conclusions
Puissant outil de mobilisations citoyennes, le mouvement des initiatives de transition cherche à construire un mouvement écologique solide par l’action “par le bas”, plutôt que de miser sur un programme politique imposé “par le haut” et par les partis politiques gouvernementaux, pour un changement systémique global et radical (à l’instar de Rob Hopkins et le mouvement des villes en transition). S’il s’agit avant tout de retrouver la puissance du niveau d'action local pour redonner confiance et capacité d'action aux citoyen.ne.s, cela peut cependant comporter des risques dans la manière de concevoir l’action politique écologique collective.
Sur le territoire de la Biovallée, ces initiatives sont nombreuses et nous sommes allé.es à la rencontre de certaines d’entre elles. Elles se situent dans des secteurs différents : éducation (L’université des Alvéoles), agriculture (L'Îlot 1000 feuilles, Oasis de Serendip), habitat collectif (Château Pergaud), lieux collectifs (Les Jardins de Samare), acteur.rices associatif d’aide au développement (Terre de lien, association Biovallée) et institutionnels (CCVD). L’histoire de ce territoire et sa nature en ont fait un terreau fertile pour l’émergence de celles-ci et d’une culture écologique commune, bien que cette dernière ne soit pas homogène.
Cependant, nous portons une attention à l’aspect dépolitisé de certaines initiatives qui se contentent d’un rôle de "construction", évitant tout conflit politique avec les acteur.ices qui ne partagent pas leur vision écologique et manquent de réelles revendications sociales et anticapitalistes pour une écologie inclusive des classes populaires et qui lutte contre les causes de la crise écologique dont les industries poussés par le profit sont la figure de proue. Ce manque d’alliance entre initiatives locales de transition et politisation comporte un danger : “c’est bien le projet néolibéral qu’elles pourraient involontairement contribuer à renforcer par leur parti pris d’atténuation des conflits” (Servigne, 2013) [5], notamment dans la stratégie de ce dernier de réduction massive et de privatisation des services publics, dans un contexte de compressions budgétaires. Comme le montre Luc Botlanski, dans “Le nouvel esprit du capitalisme” (1999), les nouvelles stratégies néolibérales se cachent sous les politiques de “focusing on localism". En prétendant rendre le pouvoir aux communautés locales et mettre en avant le principe de subsidiarité, l’Etat peut se donner un gage de désengagement.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la capacité des initiatives locales de transition à inclure les populations exclues de ce phénomène, notamment par des niveaux de capitaux culturels et sociaux inégaux. Par exemple, la plupart des associations interrogées attirent peu les populations issues de l’immigration, qui habitent pourtant les mêmes communes. Aucune personne que nous avons interrogée, même la plus engagée, n’a pu apporter de réponses face à cette barrière érigée entre des modes de vie et sociabilités incompatibles, mis à part la nécessité d’un changement de paradigme par une éducation populaire aux enjeux écologiques touchant les modes de consommation et d’alimentation.
De plus, le territoire de la Biovallée, en s’inscrivant dans les cadres de la compétitivité et attractivité entre les territoires ne peut pas faire figure d’exemple de reproductibilité mais au contraire est une exception dont l’émergence a en partie eu lieu grâce à certaines aides exceptionnelles extérieures, dans une volonté de se démarquer des autres territoires, non pas de coopérer avec eux. Les effets de cette compétitivité entraînent aussi une hausse des loyers, une gentrification, face à laquelle certains de nos interlocuteur.ices nous ont confié une détresse qui nécessiterait à minima un besoin de souplesse et d’adaptation du droit concernant les autres formes d’habitats. Ainsi, une contradiction se dévoile : en s’inscrivant dans une logique compétitive, le territoire nuit aux habitants qui participe à la création de cette compétitivité.
Ce qui ressort de nos interviews est que le rôle de l’action publique ne doit pas consister à diriger les initiatives mais bien à “créer un climat favorable à leur émergence et accompagnement” (Biovallée). Les acteurs publics pourraient davantage soutenir les petits producteur.rices par des financements en réformant la PAC (Politique Agricole Commune) ; par l’acheminement en eau qui manque terriblement dans la région; alors de la création des PAT (Projet Agricole Territorial) ; avec des formations; de la sensibilisation des jeunes etc., ou encore penser à lancer un mouvement de fermes communales achetées par les collectivités, comme le propose une bénévole de Terre de Liens.
[1] Bottom up (de bas en haut) et top down (de haut en bas) désignent, en politiques publiques, deux modalités de gouvernance : ces anglicismes tendent à remplacer dans le jargon politique et économique leurs équivalents « descendant.e » et « ascendant.e »; la première reflétant une conception plus traditionnelle du pouvoir; la seconde visant plutôt le développement d’initiatives citoyennes http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/top-down-et-bottom-up
[2] “une décrue du torrent de la croissance ; mais plus concrètement (...) il s’agit implicitement ou explicitement d’en revenir à un niveau de la vie matérielle compatible avec la reproduction des écosystèmes”, LATOUCHE Serge, « Introduction. Origine et sens », dans : Serge Latouche éd., La décroissance. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2022, p. 3-22. URL : https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/la-decroissance--9782715409606-page-3.htm >>> lien vers ressources bibliographiques lé décroissance de serge latouche
[3] Thèse de Sibylle Bui (Agro Paris Tech, https://www.theses.fr/158308573
[4] Site internet « Sagacité » : http://sagacite.caprural.org/story_html5.html?fbclid=IwAR3a7OPeBNWy4prVzMP4fp11N_YqUR0BqmiV_ARqh4n3SIY9qeTwIJ1GLSo
[5]INITIATIVES DE TRANSITION : LA QUESTION POLITIQUE Christian Jonet, Pablo ServigneLa Découverte | « Mouvements », 2013 https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-3-page-70.htm