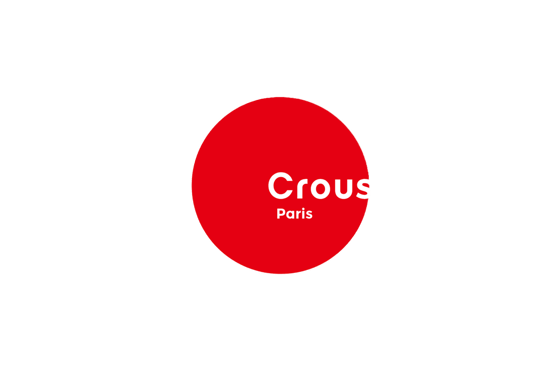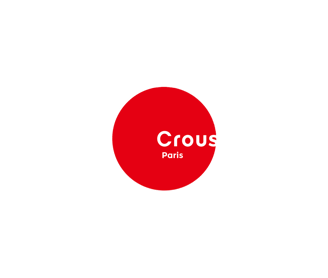À l'origine de l'association se trouvent trois ami.e.s qui peinent à trouver du sens dans les projets de vie qu’on leur promet. A la suite de questionnements, constats théoriques et empiriques, leurs convictions personnelles et militantes se sont alimentées pour finalement donner naissance à un projet qui les anime.
Nous sommes partis d'un constat : aujourd'hui, de nombreux.euses jeunes, notamment étudiant.e.s autour de nous, sont en deuil d’un monde tel qu’il nous l’a été raconté, et ne croient plus aux promesses de la croissance infinie, aux mythes avec lesquels nous avons été bercés, d’un modèle consumériste qui n’est pas pérenne et dont les effets destructeurs sont de plus en plus visibles, jour après jour. C’est pour cette raison qu’il nous a semblé nécessaire de faire connaître des alternatives, ouvrant des potentialités de solutions et d’imaginaires divergents et multiples.
Nous entendons la notion d’imaginaires comme le résultat d’une multitude de croyances qui fondent nos représentations et nos rapports au monde, à soi, aux autres, au vivant et influencent nos décisions et comportements. C’est donc intrinsèquement lié aux valeurs, habitudes et normes sociales. Nous partons du postulat que l’impasse sociale et écologique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui résulte en grande partie des imaginaires économiques et technoscientifiques, des croyances en un développement, progrès et une croissance sans limite. La volonté de “faire bouger les imaginaires” se comprend alors comme la capacité à imaginer qu’autre chose existe. Nous avons cruellement besoin de récits de vies, d'interdépendances et de solidarités qui contredisent les récits du capitalisme (John Jorda, 2018), des narrations rappelant que la résistance n’est jamais futile. Les imaginaires divergents se refusent à la réalité “telle qu’elle va”, au “réalisme” que l’on doit soi-disant accepter.
Nous sommes conscient.e.s qu’il n’existe pas de système préconçu, de solutions parfaites, et c’est pour cela que nous voulons interroger les potentiels d’expérimentations concrètes. Nous voulons aller à la rencontre des personnes qui sont dans l’action, qui proposent des innovations sociales, et ouvrent les possibilités d’un ré-enchantement de notre rapport au monde. Revendiquons notre droit au rêve, à la poésie, à la beauté !
Nos recherches, lectures et rencontres ainsi que notre intérêt pour le cinéma documentaire nous ont conduit à transformer notre quête personnelle en un projet associatif ayant pour objectif d'encourager la prise d'initiative et de proposer de nouveaux imaginaires culturels. Nous pensons, comme Rob Hopkins (2008), initiateur du mouvement international des villes en transition, que les récits peuvent être utilisés comme un outil de mobilisation et de transformation concret pour trouver de nouveaux repères en accord avec nos valeurs. Utiliser le médium du film documentaire, jouant sur la perception et les imaginaires, nous a semblé juste et adéquat pour initier un dialogue notamment au travers de projections-débats. Nous souhaitons simplement échanger sur ce qui est essentiel aux individus pour bâtir le monde de demain.
Nous nous interrogeons sur la manière dont les lieux et collectifs que nous visitons intègrent les revendications sociales, d’égalité, d’inclusion des minorités et de justice environnementale. En effet, derrière le mot “transition écologique” clamé par les pouvoir publiques et certains milieux écologistes se cache souvent un étendard culpabilisant de verdissement (greenwashing) des modes de vie bourgeois largement inaccessibles au plus grand nombre (à l’instar de la voiture électrique). Nous souhaitons interroger la capacité et les potentialités des initiatives locales, comme actions “par le bas”, à être des outils de mobilisation citoyenne, et à engendrer la sortie du déni et de l’impuissance dans laquelle nous sommes plongé.e.s. Nous voulons aussi questionner leur participation dans la construction d’un mouvement populaire solide, en retrouvant collectivement la puissance du niveau d’action locale.
Nous souhaitons ouvrir le débat sur des alternatives au modèle dominant, des initiatives diverses qui bougent les lignes, de toutes les façons ; dans la manière d’aimer, de manger, de se déplacer, de vivre, d’échanger, de lier, de s'entraider, de changer, de bouger... Geneviève Pruvost voit dans la notion de ‘quotidienneté’ la capacité à métamorphoser un terrain connu, lui conférant ainsi une dimension politique voire révolutionnaire - en ce sens que les alternatives à la norme se propagent et s'expandent - le quotidien étant le lieu de diffusion majeur des pratiques. Elle en appelle à enfouir nos mains dans la matière pour lutter contre ‘l’oubli de la matérialité qui nous fait vivre’ (dans la terre, la nourriture, le maraîchage, la création artistique).
Ainsi, la raison d'être d’Hallunissons est le partage des idées, luttes et expérimentations de nos lieux de tournages, de personnalités et projets associatifs qui nous inspirent. Parce que finalement, n’est-ce pas dans les marges que se sont élaborées les promesses du futur et les grandes évolutions de société ?
Bien sûr, nous avons pleinement conscience de notre capacité d’action très limitée et il s’agit avant tout pour nous de partager nos découvertes à notre entourage et de construire un pont entre le monde de nos idées et les terrains étudiés.
QUI SOMMES NOUS?
Agathe Petiot
Rosalie Moreau
Émile Thierry d'Argenlieu
3 copaines, étudiant.e.s en sciences sociales et politiques et ex-colocataires à Grenoble
Philippine d'Argenlieu, la quatrième personne à faire partie de l'association, est un soutien logistique primordial: depuis le début, elle nous aide à distance concernant la recherche et prise de contacts, la partie administrative, la trésorerie et la gestion des imprévus. Elle est aussi un pillier de postproduction de part ses compétences en montage vidéo.


À l'origine de l'association se trouvent trois ami.e.s qui peinent à trouver du sens dans les projets de vie qu’on leur promet. A la suite de questionnements, constats théoriques et empiriques, leurs convictions personnelles et militantes se sont alimentées pour finalement donner naissance à un projet qui les anime.
Nous sommes partis d'un constat : aujourd'hui, de nombreux.euses jeunes, notamment étudiant.e.s autour de nous, sont en deuil d’un monde tel qu’il nous l’a été raconté, et ne croient plus aux promesses de la croissance infinie, aux mythes avec lesquels nous avons été bercés, d’un modèle consumériste qui n’est pas pérenne et dont les effets destructeurs sont de plus en plus visibles, jour après jour. C’est pour cette raison qu’il nous a semblé nécessaire de faire connaître des alternatives, ouvrant des potentialités de solutions et d’imaginaires divergents et multiples.
Nous entendons la notion d’imaginaires comme le résultat d’une multitude de croyances qui fondent nos représentations et nos rapports au monde, à soi, aux autres, au vivant et influencent nos décisions et comportements. C’est donc intrinsèquement lié aux valeurs, habitudes et normes sociales. Nous partons du postulat que l’impasse sociale et écologique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui résulte en grande partie des imaginaires économiques et technoscientifiques, des croyances en un développement, progrès et une croissance sans limite. La volonté de “faire bouger les imaginaires” se comprend alors comme la capacité à imaginer qu’autre chose existe. Nous avons cruellement besoin de récits de vies, d'interdépendances et de solidarités qui contredisent les récits du capitalisme (John Jorda, 2018), des narrations rappelant que la résistance n’est jamais futile. Les imaginaires divergents se refusent à la réalité “telle qu’elle va”, au “réalisme” que l’on doit soi-disant accepter.
Nous sommes conscient.e.s qu’il n’existe pas de système préconçu, de solutions parfaites, et c’est pour cela que nous voulons interroger les potentiels d’expérimentations concrètes. Nous voulons aller à la rencontre des personnes qui sont dans l’action, qui proposent des innovations sociales, et ouvrent les possibilités d’un ré-enchantement de notre rapport au monde. Revendiquons notre droit au rêve, à la poésie, à la beauté !
Nos recherches, lectures et rencontres ainsi que notre intérêt pour le cinéma documentaire nous ont conduit à transformer notre quête personnelle en un projet associatif ayant pour objectif d'encourager la prise d'initiative et de proposer de nouveaux imaginaires culturels. Nous pensons, comme Rob Hopkins (2008), initiateur du mouvement international des villes en transition, que les récits peuvent être utilisés comme un outil de mobilisation et de transformation concret pour trouver de nouveaux repères en accord avec nos valeurs. Utiliser le médium du film documentaire, jouant sur la perception et les imaginaires, nous a semblé juste et adéquat pour initier un dialogue notamment au travers de projections-débats. Nous souhaitons simplement échanger sur ce qui est essentiel aux individus pour bâtir le monde de demain.
Nous nous interrogeons sur la manière dont les lieux et collectifs que nous visitons intègrent les revendications sociales, d’égalité, d’inclusion des minorités et de justice environnementale. En effet, derrière le mot “transition écologique” clamé par les pouvoir publiques et certains milieux écologistes se cache souvent un étendard culpabilisant de verdissement (greenwashing) des modes de vie bourgeois largement inaccessibles au plus grand nombre (à l’instar de la voiture électrique). Nous souhaitons interroger la capacité et les potentialités des initiatives locales, comme actions “par le bas”, à être des outils de mobilisation citoyenne, et à engendrer la sortie du déni et de l’impuissance dans laquelle nous sommes plongé.e.s. Nous voulons aussi questionner leur participation dans la construction d’un mouvement populaire solide, en retrouvant collectivement la puissance du niveau d’action locale.
Nous souhaitons ouvrir le débat sur des alternatives au modèle dominant, des initiatives diverses qui bougent les lignes, de toutes les façons ; dans la manière d’aimer, de manger, de se déplacer, de vivre, d’échanger, de lier, de s'entraider, de changer, de bouger... Geneviève Pruvost voit dans la notion de ‘quotidienneté’ la capacité à métamorphoser un terrain connu, lui conférant ainsi une dimension politique voire révolutionnaire - en ce sens que les alternatives à la norme se propagent et s'expandent - le quotidien étant le lieu de diffusion majeur des pratiques. Elle en appelle à enfouir nos mains dans la matière pour lutter contre ‘l’oubli de la matérialité qui nous fait vivre’ (dans la terre, la nourriture, le maraîchage, la création artistique).
Ainsi, la raison d'être d’Hallunissons est le partage des idées, luttes et expérimentations de nos lieux de tournages, de personnalités et projets associatifs qui nous inspirent. Parce que finalement, n’est-ce pas dans les marges que se sont élaborées les promesses du futur et les grandes évolutions de société ?
Bien sûr, nous avons pleinement conscience de notre capacité d’action très limitée et il s’agit avant tout pour nous de partager nos découvertes à notre entourage et de construire un pont entre le monde de nos idées et les terrains étudiés.
QUI SOMMES NOUS?
Agathe Petiot
Rosalie Moreau
Émile Thierry d'Argenlieu
3 copaines, étudiant.e.s en sciences sociales et politiques et ex-colocataires à Grenoble.
Philippine d'Argenlieu, la quatrième personne à faire partie de l'association, est un soutien logistique primordial: depuis le début, elle nous aide à distance concernant la recherche et prise de contacts, la partie administrative, la trésorerie et la gestion des imprévus. Elle est aussi un pillier de postproduction de part ses compétences en montage vidéo.