Puisque le but de ce blog est avant tout le partage, on a sélectionné tout un tas de bouquins, ouvrages, articles, et revues qui ont contribué à la construction de notre parole et notre pensée, sur l'écologie politique. Vous trouverez une liste non-exhaustive de ressources bibliographiques que nous vous recommendons.
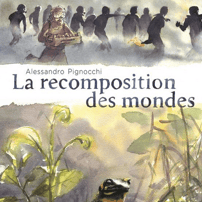
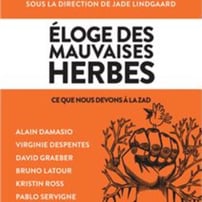
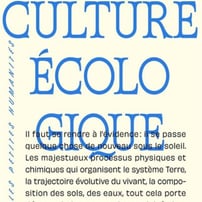
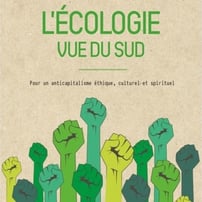
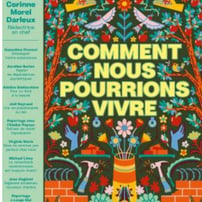
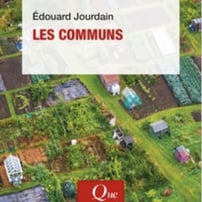
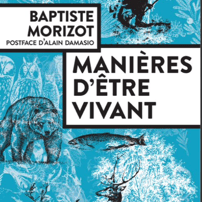
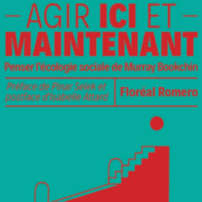
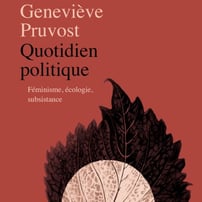
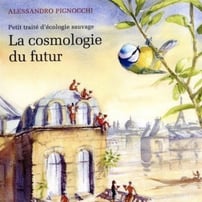
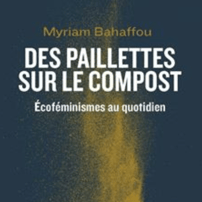
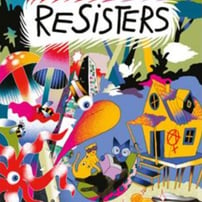
Livres et ouvrages
Éloge des mauvaises herbes. Ce que nous devons à la ZAD. Coordonné par Jade Lingaard qui a rassemblé de nombreux textes d'intellectuel.le.s et écrivain.e.s qui expliquent que la "Zone à Défendre" DE Notre-Dame-des-Landes est bien plus qu'un petit bout de bocage en lutte. À travers les voix de Vandana Shiva, Christophe Bonneuil, Virginie Despentes, Amandine Gay, Bruno Latour, Geneviève Pruvost et bien d'autres, se dessine un carré de mauvaises herbes dans un paysage bétonné, normé et artificialisé, dans lequel s'invente de nouvelles formes de vies et de liberté absolument nécessaires, tentative de faire d'une forme de résistance un modèle de ce à quoi la société à laquelle on pourrait aspirer pourrait ressembler. "Alors ceux qui défendent -dans leur vie quotidienne, qui font l'expérience réelle d'une vie alternative avec tout ce qu'elle comporte de complexité et de déceptions-, ces gens-là sont des chercheurs. La zone qu'ils défendent est précieuse : c'est l'espace infime à l'intérieur duquel on se souvient qu'autre chose est possible”.
Des paillettes sur le compost, Myriam Bahaffou: un essai-roman à la fois drôle, passionnant, honnête et cru, avec une pincée de cynisme, de la chercheuse en philosophie féministe et militante écolo anticapitaliste qu’on adore!! un livre qui réinjecte l’écoféminisme dans le quotidien, dans des situations concrètes (l’épilation intégrale; le steak pour monsieur et la salade pour madame au restaurant; son auto-nomination de slut) et dans la manière dont il s’incarne dans sa chair, de réinvestir le mot face à “l’océan de greenwashing, de blanchiment et d’intellectualisation actuelle des écoféminismes”. Un mouvement libertaire, décolonial (les premières écoféministes sont des minorités de genre, pauvres du “Sud globalisé”), révolutionnaire, anticapitaliste et spirituel (une écologie relationnelle qui implique un langage de l’invisible, qui 'dessine une multiplicité de rapports au monde, qui convoquent le soin, l’imagination, les relations inter espèces', se développant hors de l'épistémologie hétéropatriarcale’), non essentialiste (elle décapite le mythe de la binarité entre les tueurs d’oiseaux et des mangeuses de feuille) ;qui naît de la pauvreté avant tout (car existe dans ‘des espaces de contestation du néolibéralisme, du colonialisme, du patriarcat, et de la violence qu’ils perpétuent sur les corps’), une écologie plus émotionnelle, sensible et débordante que rationnelle : c’est ça, avant tout, l’écoféminisme !
Culture Écologique, Pierre Charbonnier: Agathe a suivi les cours d'écologie politique du philosophe Charbonnier, dont le livre en est vraiment la synthèse. Cet ouvrage veut porter à la connaissance du plus grand nombres les débats qui organisent la question écologique, convoquant à la fois les sciences de la terre, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire et la philosophie, pour dresser le portrait de ce que l'on nomme "écologie", constituant ainsi une base fondamentale dans la compréhension des critiques de la modernité, du capitalisme, du progrès et de l'invention de la "nature" comme ressources à gérer.
ReSisters, Jeanne Burgart Goutal & Aurore Chapon. Un roman graphique qui nous plonge dans un univers dystopiques (et pourtant terriblement familier) pour apporter une réflexion sur l'écoféminisme et la manière dont ce courant peut apporter une forme de réponse politique pour sortir du capitalisme néocolonial patriarcal et réinventer un destin commun et désirable.
Petit traité d’écologie sauvage; La cosmologie du future et Mythopoïese de Alessandro Pignocchi: Bd dans laquelle le chercheur en sciences cognitives et philosophie imagine un monde où, grâce à des mésanges punks qui ont renversé les États, la pensée animiste des Indiens d’Amazonie (les Jivaros, étudié par l’anthropologue Philippe Descolat) est devenue la pensée dominante: les plantes et animaux sont désormais considérés comme ayant une individualité (avec une vie intellectuelle et sentimentale) et les chefs n’ont plus de pouvoirs. Alors, un anthropologue jivaro tente de sauver ce qu’il reste de la culture occidentale en se rendant dans les enclaves (tel que Bois-le-roi) où sont réfugiés nos ex-dirigeants politiques. Entre le Grand débat national, la prise en compte des intérêts de Notre-dame-des-landes et le plan biodiversité, un premier ministre qui fait de l’éclosion des hannetons sa priorité, la Turquie qui élit une chèvre à sa tête, une angela merkel et un trump sous acide autour d’un feu, on plonge presque dans une utopie… Du même auteur, on a aussi adoré
Réveillons-nous ! , Edgar Morin: Court manifeste signé par le philosophe centenaire, dans lequel il tente de donner des clés de compréhension à l'aveuglement général face à la crise en cours qui tiendrait à la conception linéaire et mécaniste de l'avenir. Il fait le portrait d'une ère nouvelle qui nous contraint à attérir en prenant conscience de la communauté de destin du genre humain et du vivant puisqu'aujourd'hui, "nous croyons posséder les recettes du développement alors que nous sommes possédés par un mythe techno économique". Alors que "nous devrions savoir que l’histoire ne progresse pas de façon linéaire mais par déviances qui se fortifient et deviennent tendance"
.L’écologie vue du sud. Pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel, Mohammed Taleb. Un clivage central traverse l’écologie selon le philosophe: à l’écologie dominante des société occidentales; qui prétend définir les enjeux de la crise environnementale et impose et diffuse sa seule analyse et représentation de l’environnement, proposant un seul processus de résolution du « probleme »; s’oppose l’écologie du Sud, « un ensemble réfractaire à l’hégémonie occidentale capitaliste. Cette dernière est avant tout une démarche d’alternatives et de résistances, d’une écologie qui ne considère pas la nature comme un agrégat de ressources utiles à l’humain et qui est portée par les peuples qui se trouvent « socialement, culturellement, économiquement et politiquement à la périphérie du système-monde-Occident ». Des luttes paysannes indiennes au Mouvement des « sans terre » au Brésil, en passant par la résistance éco paysanne en palestine et l’écosocialisme et son credo « buen vivir » et bien d’autres mouvement, ce livre fait le portrait de résistances locales qui lutte contre la dépossession de leurs terres et appel à un universalisme pluriel. Comme dans la plupart des civilisations du Sud de la planète, le culturel et le spirituel ne sont pas deux réalités distinctes. La vie culturelle est toute pénétrée de sagesse et celui-ci étend sa présence jusque dans les gestes les plus ordinaires, de la façon de cuisiner à la façon de s’habiller.
Vivre en Éco-lieux, Le monde de demain se construit aujourd'hui: C'est l'histoire de deux jeunes, Cristo Corbeau & Romane Rostoll, qui décident de quitter leurs jobs et vies urbaines respectives pour se lancer dans un tour de France des écolieux pendant toute une année, et tenter de répondre à leur question brûlante : Comment construire sa vie dans un monde qui ne tourne pas rond. Organisé en 5 parties distinctes (la démarche philosophique, l'organisation résiliente, la politique et gouvernance, et l'objectif stabilité), ce livre est plein de ressources (notamment sur les enjeux juridiques et urbanistiques des habitats légers) et de comparaisons entre différents fonctionnements.
Le Manuel de la Transition et Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons? , Rob Hopkins. Initiateur du mouvement international des villes en transition, Hopkins pose la question "Comment pourrions-nous espérer bâtir un monde si différent si nous ne sommes pas d'abord capable de l'imaginer?". Si nos structures sociales, institutions, lois, moyens d'échanges et normes sont une succession de fictions et créations collectives d'origine humaine, alors tout trouve sa source dans les croyances, parfois si ancrées qu'on les confonds avec la réalité. Si, arrivé à un certain âge, la société nous presse de devenir des adultes "raisonnables" qui cessent de rêver, alors "au diable la raison et rouvrons l'espace des possibles". "Manuel de transition" donne les 12 étapes de transition pour créer des communautés résilientes. Nous interpellons cependant sur le manque de positionnement et rapport de force politique concernant ces initiatives qui peuvent finalement recréer les mêmes dominations ethno-socio-économiques si elles ne prennent pas en compte un véritable humanisme qui n'est pas qu'une utopie blanche privilégiée.
Agir ici et maintenant: penser l’écologie sociale de Murray Bookchin, Floréal Roméo. Issus de la tradition anarcho-syndicaliste espagnole, l'auteur propose ici une relecture actuelle du penseur radical de l’écologie social Murray Bookchin, pour appréhender les racines de l’ordre social et proposer une intense convergence entre l’anarchisme, l’écologie et la philosophie dialectique. Du Rojava (ou Kurdistan occidental, région rebelle autonome au nord de la Syrie) à l’Espagne (avec la révolution espagnole et la CNT) en passant par le Chiapas et les luttes zapatistes, l’auteur propose des voie d’élaboration d’une convergence des luttes et alternatives afin de faire émerger un nouvel imaginaire comme puissance collective. Il propose des réponses aux questions: comment vivre, s’organiser, produire, cultiver, habiter, décider et partager, en somme, comment imaginer un futur qui ne soit pas une contre utopie du genre transhumaniste ? Il questionne et éclaire sur ce « spectacle » qui consiste à nous jeter la poudre aux yeux du changement climatique et de la gestion des émissions de CO2 en nous rendant soit disant capables, de manière individuelle, d’inverser les courbes en nous focalisant sur la responsabilité de chacun et insistant sur la culpabilisation. « Nous ne pouvons plus nous en remettre à des lendemains qui chantent en allusion à d’hypothétiques pratiques communautaires isolées même libertaires et en vantant les louanges de l’entraide. Ces pratiques communautaires ne font sens que si elles s’insèrent dans un projet politique plus vaste, capable d’articuler le lien dans une stratégie basée sur les luttes et les alternatives ».
La décroissance, Serge Latouche, Court texte qui introduit avec clarté et nuances les tenants et aboutissants ainsi que les controverses liées à la décroissance, écrit par l’un de ses principaux théoriciens, l’économiste Latouche. En résumé, l’objectif du projet de décroissance sont, une fois la société libérée du totalitarisme productivisme et de l’impérialisme économique, d’instaurer un système de nouvelles valeurs, ouvrant un espace de diversité culturelle et d'alternatives au productivisme, sans constituer un modèle unique de société alternative mais « une matrice de possibilités alternatives ». La décroissance repose avant tout sur le cercle vertueux de sobriété des 8 « R » : réévaluer, reconceptualiser, restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, réutiliser, recycler. Cela passe donc par cinq facteurs : la réduction de la productivité globale due à l'abandon du modèle thermo-industriel et au rejet des techniques polluantes ; la délocalisation des activités et l'arrêt de l'exploitation au Sud ; la création de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs ; la réduction massive du temps consacré aux activités productives ; le changement des modes de vie et la suppression des besoins inutiles. Le livre ancre la décroissance dans des courants de pensée plus large, des socialistes-marxistes-anarchistes de la fin du XXè (Marx, Engels, Thoreau, Bakounine, Kropotkine, Proudhon) aux philosophes, économistes et sociologues qui critiquent la société de consommation après la seconde guerre mondiale (André Gorz, Bénard Charbonneau, Ellul, Ivan Illich, Murray Bookchin). Selon lui, notre société moderniste occidentale est la seule culture qui a fait de la croissance abstraite du capital - et non de la croissance biologique - sa religion.
Réparer le monde. Humains, animaux, nature, Corine Pelluchon : Corpus de textes de la philosophe qui décrivent les manières dont on peut apprendre à habiter la Terre, à cohabiter avec les autres en sortant de la logique destructrice nous conduisant droit vers la dévastation de la planète et à une crise sociale et politique majeure. Elle entend l’heure de la réparation comme celle de l’évitement du pire et du dépassement du chaos qui passe par une éthique du « care ». « C’est imaginer qu’un autre modèle de développement est possible. Il exige un remaniement complet de nos représentations, de la manière dont nous pensons la place de l’humain dans la nature et dont nous interagissons avec les autres, y compris les animaux ».
L’entraide, l’autre loi de la jungle et Comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne, Chappelle et Stevens: Les deux ouvrages les plus connus du collapsologue Pablo Servigne. La collapsologie ou l’effondrisme soutient qu’une rupture historique brutale approche à cause sur la chute de notre civilisation thermo-industrielle. Basée sur la théorie des systèmes complexes et une vision assez “mécaniste” des interrelations au sein du système Terre, l’effondrement se caractérise par un processus à l’issu duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie) ne sont plus fournis à coûts raisonnable a une majorité de la population par des services encadrés par la loi (Yves Cochet). Bien que critiqué par nombreux.euses penseur.euses écologistes car instrumentalise la peur et est surtout plutôt politiquement inoffensif car il s’agit de fantasmer sur une sorte de fin du monde tel qu’on le connaît qui nous forcera à nous reconnecter à l’essentiel; ces deux ouvrages valent le coup d’être lus car sont assez complets et riches car avant tout transdisciplinaires (anthropologie, ethnologie, psychologie, neurosciences, histoire etc). Le premier explore les conditions d’émergence des comportements d’entraide; questionnant la mythologie dominante de la “loi du plus fort” qui imprègne nos modes d'organisations compétitifs, Servigne démontre ici que “ceux qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcéments les plus forts mais ceux qui s’entraident le plus”, cette “autre loi de la jungle” qu’est donc l’entraide, la solidarité, la coopération. Le second, quant à lui, est une bonne introduction concise aux théories de l’effondrement, et dont la conférence “un avenir sans pétrole” de la Chaire Agro SYS trouvable sur youtube en est un bon résumé.
Les métropoles barbares, Démondialiser la ville, désurbaniser la terre, Guillaume Faburel. En tant que géographe, l'auteur tente de reconsidérer l'aménagement et l'occupation spatiale autrement que dans l'hypercentralisation autour de grandes métropoles, pour tendre plutôt vers des villes. Ce dernier défend des initiatives post-urbaines qui cherchent à faire corps avec le vivant pour renouer avec un régime d'entraide et de solidarité.
La Plaine. Récits de travailleurs du productivisme agricole, Gaëtan Elie. Il s’agit d’une enquête sociale réalisée dans la plaine de la Beauce, région spécialisée dans la céréaliculture intensive et productiviste. À travers différents entretiens qui se complètent et s’opposent, d’horizons différents (d’agriculteurs à commerciaux du Crédit Agricole en passant par des membres de la FNSEA et des gestionnaires de grandes exploitations), ce récit questionne le consentement des travailleurs au productivisme et l’évolution historique de la concentration foncière (lorsque les fermes s’agrandissent, mettant un terme au modèle beauceron associé aux petits exploitants parcellaire au profit des grands fermiers capitalistes qui deviennent des managers de l’efficacité) et de l’agriculture moderne. À travers les paroles retranscrites des interrogés, ,nous pouvons reconstruire l’historicité de l’avènement de la modernité agricole qui a voulut toujours travailler « plus vite, plus grand »: le XIXe siècle donne naissance aux intrants de synthèses (qui seront jeté sur le marché en grandes quantités particulièrement lors des guerres mondiales) et aux grandes banques commerciales nécessaires à l’obtention des capitaux nécessaires pour investir dans les innovations techniques ; le XXe est marqué par une banalisation du monde de la terre couplé à la division du travail du taylorisme et fordisme, le régime de Vichy introduit le contrôle étatique sur les semences dans un contexte de pénuries alimentaires, rendre la France rurale efficace et exportatrice au sortir de la Libération en fixant ds surfaces minimums d’installation; un recadrage modernisateur de l’agriculture comme stratégie nationale pendant les 30 glorieuses; l’arrivée des multinationales dans les 1980 a accrut l’esprit de compétition face à la dérégularisation. Le livre rentre dans les détails d’une inertie politique concernant ce modèle dont les conséquences destructrices ont bel et bien été démontrées (la présence de gros producteurs céréales intégrés aux filières agro industrielles au Ministère de l’Agriculture; les données sur la toxicité et dangerosité des pesticides et fongicides qui sont pour la plupart du peu produites, réalisées par des firmes agrochimiques pour valider leurs dossier d’homologation; l’homogénéisation et la standardisation des semences qui doivent être stabilisées génétiquement, au détriment des variétés anciennes et locales, pour favoriser la mécanisation de l’agriculture, « la moissonneuse batteuse ne tolérant par le chaos du vivant »). Paradoxalement, une nature domestiquée est extrêmement fragile: en cherchant à produire davantage, l’agriculture intensive a rendu les exploitations agricoles vulnérables car la non diversité des parcelles monovariétales ne permet aucune limitations des effets de propagation d’un événement climatique, de maladies ou d’attaques de nuisibles que permettrait une diversité d’espèces dans un écosystème.
Manières d’être vivant, Baptiste Morizot: Le philosophe-pisteur entend dans ce livre jeter toute la force du vivant, des différentes “manières d’êtres vivant” pour questionner le lecteur et la société humaines au sens large sur la relation entretenu avec la vie, le vivant, humain et autres qu'humains. Il pense la crise écologique comme une crise de la sensibilité, une crise dans la relation humaines au vivant, d’humain.e.s qui ont pris l’habitude d’entretenir des relations “à la nature” comme une simple ressource à disposition, un décor, ou un lieu de transcendance, sans accepter leur identité de vivants. Comment peut-on apprendre à se sentir vivants, s’aimer vivants, et se sentir comme appartenant à une communauté de destin des vivants? “Comment imaginer une politique des interdépendances, qui allie la cohabitation avec des altérités, à la lutte contre ce qui détruit le tissu du vivant ?”. Il invite le.la lecteur.rice a pratiquer un art des attentions (qui est politique dans la mesure où la “modernité” nous a coupé de cette attention aux altérités et autres formes de vie), à se rendre disponibles aux signes des autres formes de vie pour déboucher en dehors des dualismes. “À force de ne plus faire attention au monde vivant, aux autres espèces, aux milieux, aux dynamiques écologiques qui tissent tout le monde ensemble, on créé de toute pièces un cosmos muet et absurde qui est très inconfortable à vivre à l’échelle existentielle, individuelle et collective. mais, surtout, on génère un réchauffement climatique et une crise de la biodiversité qui menacent concrètement les conditions d'habileté de la Terre”
Quotidien Politique, féminisme, écologie et subsistance, Geneviève Pruvost : Sociologue du genre et du travail, G. Pruvost a enquêté pendant plus de 10 ans dans des lieux d'expérimentations de l’écologie pratique. Dans ce livre, elle revient sur le pouvoir révolutionnaire qu’est la fabrique du quotidien et l’anonymisation de la fabrique de la quotidienneté (de tous nos biens de subsistance) dans les sociétés capitalistes industrialisées.
Les communs Édouard Jourdain, Court essai qui introduit de manière très claire et synthétique le substantif “communs” (qui provient de l’anglais Commons), qui, malgré un usage assez récent en France (face à la menace de leur disparition), désigne une réalité bien plus historique. Les communs sont des biens et ressources “liés à des communautés, et donc à un sens collectif, amenant les individus à négocier et à communiquer dans une perspective qui ne se réduit pas à des intérêts immédiats: faisant l’objet d’un auto-gouvernement qui n’est imposée ni par le marché, ni par l’état, le souci des biens communs est toujours de concilier le droit d’usage avec la préservation des ressources”. Ils peuvent exister partout, et durant nos études de terrain, on en découvre un paquet (des jardins partagés aux fours à pains, des sciences ouvertes et participatives aux AMAPs, des épiceries coopératives aux logiciels libres…)!. Jourdain revient notamment sur les apports des travaux d’Elinor Ostrom sur les communs et leur capacité d’action inédite car orientée vers la prise en charge collective des besoins de bases, de manière éminemment politique, donc, passant par la ré-invention de nouvelles formes d’organisations et de coopération. Elle affirme que le hiérarchie et la soumissions (concernant l’État) et l'intérêt privé et la compétition (concernant le marché), ne sont finalement que deux modes de gestion et distribution des ressources parmi d’autres alors même que les individus sont dotés d’une réelle capacité à entrer en coopération par la prise en compte d'intérêts communs. L’auteur revient aussi sur les phénomènes d'enclosures, mouvement désignant des changements opérés en Angleterre (dès le XIIè s. puis surtout entre le XVI et XVIIè siècle) concernant l'agriculture traditionnelle, limitant l’usage des terres seigneuriales à quelques personnes désignées pour chaque champ étant désormais séparé du champ voisin par une barrière ou une haire (type bocage). Cela marque la fin des droits d’usages des biens communaux dont la plupart des paysans dépendaient.
Les biens communs : un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle ? sous la direction de Perrine Michon. Dans cet ouvrage, plusieurs auteurs donnent leur définition de bien(s) commun(s) comme organisation souhaitable des rapports sociaux de notre ère. Il aide à comprendre et concevoir les rapports des hommes aux territoires et à l'environnement mais aussi les rapports des hommes entre eux et à eux-mêmes.
Écologie des territoires, Transition et biorégions, dirigé par Thierry Paquot qui laisse la parole à un juriste, un politologue, un professeur de traductologie, une géographe, un architecte, un philosophes, une journaliste pour donner une vision pluridisciplinaire du territoire. L'ouvrage permet d’observer le territoire de points de vue divers et de trouver des liaisons entre ces approches, mais aussi de donner un aperçu de ce que pourraient être les biorégions, modèle qui inspire plus d'un chercheur....
Articles académiques
Faire village autrement. Des communautés introuvables aux réseaux d’habitats légers, Geneviève Pruvost, Socio-Anthropologie, 2015. Monographie de tout en réseau d’entraide proche de Paris avec de nombreux habitats légers, territoire au sein duquel se sont essaimé, à partir d’un groupe de base, de nombreuses expérimentations locales décroissantes pour former un véritable “essaim” (sur un rayon de 20km2) contribuant à assurer sa continuité. Depuis l'organisation qui repose sur l’horizontalité et le rejet de toute institutionnalisation au profit de l’association spontanée, jusqu’aux manières d’aimer qui forment une ""écologie relationnelle" car aux antipodes d’une ruralité patriarcale régie par le mariage, en passant par un nomadisme voulue qui permet d’assurer la diffusion des alternatives et un brassage continue, source de quotidien riche et varié (contrairement à la lecture classique d’une ruralité statique) : tout concorde à former un réseau réticulaire qui fait village.Ainsi, s”’élabore ici une ruralité originale, qui ne vit pas hors sol, intégrée au territoire – sans être pour autant traditionaliste et régionaliste”“, terrain qui prouve qu’”il est possible d’échapper aux sirènes du consumérisme mar- chand en réformant hic et nunc son mode de vie, collectivement, chacun dans son « chez soi » du moment en incarnant des utopies concrètes – très habitées”.
Decolonizing Relationship with Nature: colonization, eurocentrism and anthropocentrism, Val Plumwood. Dans ce chapitre 3 du livre "Decolonizing Nature: strategies for conservation in a post-colonial era”, la passionnante philosophe et anthropologue australienne Val Plumwood analyse les structures coloniales à l’oeuvres du système colonial eurocentrique et les défaillantes relations entretenus avec la nature : ainsi, elle lie intrinsèquement la colonisation et le rapport occidental destructeur à la nature, montrant que le concept de colonisation s’applique aussi directement à la nature (qu’elle nomme “more-than-human-world”). En fait, la relation entre les humains et le monde naturel pourrait être qualifiée de colonisation. Ainsi, la colonisation de la nature s’appuie sur une série de stratégies qui sont également employées dans la sphère humaine pour soutenir le suprémacisme de la race et le pillage des peuples autochtones (que ce soit un processus d’hyper-séparation entre l’identité dominante et l’identité subordonnée; celui de l’homogénéisation qui nie toutes les diversités sociales, religieuses, culturelles ou biologique du colonisé; ou encore celui de la polarisation entre l’”Autre”, marqué comme une déviation de la centralité de l’”Un”). Pour l’autrice, le ‘progrès’ est en fait le dépassement progressif et le contrôle de la sphère dite ‘étrangère’ (la nature, mais aussi les peuples colonisés ou les femmes dans une société patriarcale), par la sphère rationnelle de la culture européenne et de la ‘modernité. “The Eurocentric colonial system was one of hegemony – a system of power relations in which the interests of the dominant party were disguised as universal and mutual, but in which the colonizer actually prospered at the expense of the colonized”.
Écoféminisme décolonial: une utopie? Myriam Bahaffou, Article paru dans la revue AssiégéEs, #4 : Utopies. Écrit depuis la ZAD de Bure (contre le projet cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires ultra toxiques), cet article clarifie la place des rapports sociaux de race au sein du discours écoféministe et redonne sa place centrale et fondatrice à la question décoloniale au sein de l’écologie. S’il entend abolir la dualité nature/culture qui régissent nos rapports au vivant, le décolonial y est primordial dans la mesure ou ce sont les esclavagisées, les personnes considérées comme “sauvages” ou “non-civilisées” qui sont reléguées du côté de la nature. “ “Je crois que je suis mieux placée pour savoir de quoi je parle quand je parle d’écologie, puisqu’il s’agit de mes proches qui travaillent en usine et qui s’intoxiquent, le pays de mes ancêtres qui a servi de terrains pour vos tests nucléaires, les corps de mes sœurs qui ont été stérilisés de force, et ceux des femmes des Suds en général qui sont les plus exposées à toutes les catastrophes climatiques que l’on connaît”.
The Trouble with Wilderness: Or, Getting Back to the Wrong Nature, William Cronon, 1996, Environmental History. .Un article primordial dans la comprehnsion de ce que nos sociétés considèrent comme la “nature” sauvage, vierge et désirable. Sachant que tout ce que l’on considère comme naturel est toujours construite par l’homme, cette notion de “wilderness” est totalement artificialisée et sublimée, car elle voit une nature “en dehors”, celle qui est “à protéger”, en extrayant l’humain des relations et interactions avec le vivant et cette “nature”. Cette wilderness (régions sauvages) est donc une construction culturel qui cache la diversité de l’environnement qui nous entoure et dans lequel nous évoluons constamment, et qui semble vouloir protéger seulement cette idée romantico-bourgeoise d’une nature “là-bas”, vierge et intouchable.
Initiatives de transition: la question politique, Christian Jonet, Pablo Servigne, Cairn, Mouvements, 2013 . Cet article revient sur les risques politiques que le mouvement des “initiatives de tranditions” (qui veulent retrouver collectivement et rapidement la puissance du niveau d’action locale face au constat du manque de réaction des gouveernements) comporte, notamment leur potentiel contribution au désamorçage de toute velleité de lutte sociale si elles restent apolitiques et si elles ne revendiquent pas l’égalité avant tout. Aussi, prenons garde ! : Au terme de trente année de néolibéralisme triomphant, est-il nécessaire de rappeler que « le capitalisme s’appelle “développement”, la domination est devenue “partenariat”, l’exploitation a pris le nom de “gestion des ressources humaines” et l’aliénation est qua- lifiée par le terme de “projet”» ? L’article incite donc à ne pas opérer en un découplage entre les questions de résilience et de justice sociale et insiste sur la nécessité d’envisager les idées de luttes collective et de revendication sociale au sein de l’enthousiasme d’un mouvement qui, in fine, constitue un réel laboratoire social qui grandit discrètement, tel un rhizome et dont la croissance de ses racines aura peut-être un jour “recouvert une trop grande partie de l’ancien monde”.
Revues
Socialter, Critique radicale et alternatives :un magazine papier bimestriel disponible en kiosque dans toutes la France. Et en particulier : Le hors -série : Comment nous pourrions vivre N*13: consacré spécialement aux utopies, ce riche hors série faire un état des lieux des nombreuses utopies historiques qui ont eu lieu, avant de proposer un regard croisé sur les socialismes utopiques et libertaires. On y retrouve ensuite un entretien avec le philosophe Aurélien Berlan, philosophe et agriculteur, qui critique la conception moderne de la liberté, en montrant que la liberté au sens libérale et individualiste se résume à l’émancipation de la pénibilité matérielle, la délivrance des tâches cet contraintes de la vie quotidienne, qui implique alors un système d'exploitation de la nature et des hommes car nécessite de les faire faire par d’autres. La liberté libérale extra-terrestre nous conduisant finalement à un asservissement, il propose une conception collective de la liberté comme autonomie, comme capacité à prendre en charge les nécessités de la vie quotidienne, avec une réelle prise en compte des interdépendances. Un entretien avec Paul Noudelmann introduit le concept de la “créolisation” (Edouard Glissant, pensée des Antilles) qui refuse le logiciel intellectuel occidental et ses conceptions englobantes et ses recherches d’absolu et sens transcendant unique pour proposer une pensée du divers, du multiple, de la relation. Dans ce numéro, on apprend aussi que la biomasse des mammifères terrestres sauvages avant l’expansion de l’agriculture, il y à 10 000 ans, représentait 97%, face à 3% d’êtres humains. Aujourd’hui, le chiffre est inversé: les animaux sauvages représentent 3% de la biomasse totale, l’être humain 37%, et les animaux domestiques 60%... On trouve aussi un mode d’emploi d’”ensauvagement démocratique”, un entretien avec Geneviève Pruvost et la notion de quotidienneté, une enquête sur la région rebelle du Rojava (Kurdistan occidental)... puis on s’arrête là, on ne vous dit pas tout ! & Le hors-série L’écologie ou la mort N*12: très complet, ce numéro revient sur les différents courant de pensées de l’écologie politique et permet une bonne vue d’ensemble des fondamentaux (l’écologie anti-industrielle, l’écologie profonde, l’éthique de la terre, l’effondrisme, l’écologie sociale, l’écosocialisme, l’éco-féminisme, la décroissance, l’écologie intégrale, l’écologie décoloniale). On y retrouve aussi un chouette manuel de rhétorique à l’usage des repas de Noël, une explication détaillée du rapport du GIEC, et surtout une lettre ouverte au mouvement écologiste écrite par Murray Bookchin en 1980, sur l’avenir du mouvement écologiste, une lettre dans laquelle il fait la distinction entre l’écologie radicale qui, du latin radicalis (racines), entend questionner les racines des problèmes et veut balayer les dominations; contrairement à une écologie institutionnelle en vogue, un "environnementalisme" qui fait finalement l’appendice du système. Une lettre tristement d’actualité, une lettre dont on vous l'a ajouté en lien car elle vaut le coup d’être lue. “Je suis inquiet de la mentalité technocratique très répandue et de l’opportunisme politique”; l’écologie doit donc “commencer sa conquête de la liberté à l’usine, au sein de la famille, dans l’économie, dans le psychisme, dans les conditions matérielles de la vie comme dans ses conditions spirituelles”.
Terrestres, Revue des livres, des idées et des écologiques. Plateforme en ligne d’intellectuelles engagé.e.s, ultra riche, avec des tas d’articles, d’essais, de fiction, de poèmes, de rencontres, d’audios et autres formes hybrides qui entendent éclairer les enjeux actuels et futurs d’une véritable écologie politique. Aussi, la dynamique collective “Reprise de terre” - un travail d’enquête d’un collectif (que nous avons rencontré aux Lentillères) qui tente de trouver des fronts communs face aux questions d’acquisitions foncières, emprises de terre, accaparement de l’agriculture par le capital et le productivisme- est en grande partie hebergée sur le site, dans la rubrique prévue à cet effet. Reprise de Terre fait le lien, recueil et invente les tactique foncières, politiques et juridique pour contrer ces accaparements et saccage des terres et du vivant, en se demandant: ‘comment organiser à nouveau la vie autour de communs qui prennent en compte tous les êtres qui habitent un lieu?”. Cette dynamique réunit 3 axes: paysan et agricole (avec toutes les perspectives d’aides à l’installation paysannes), sauvage (lié à la conservation et l’ensauvagement), la ville et les milieux urbains (l’emprise de la terre en ville, les jardins etc).
Revue Basta! : un média indépendant d'investigation qui traite des questions sociales et environnementales, à travers des enquêtes, des reportages, des articles d'analyse , lancé en 2008 et piloté par une association à but non lucratif.
Revue Ballast, “Tenir Tête, fédérer, amorcer”, animér par un collectif de militant.es-bénévoles, exclusivement en ligne, réserve vivante de savoirs et débats sur l’ensemble des courants d'émancipation et de transformation sociale à travers le monde, avec tout plein d’articles trop cools. “Il s’agira de mêler la théorie et le ras de terre, l’analyse et le plan serré sur l’ordinaire. De combiner entretiens et reportages, littérature et philosophie politique, économie et poésie. De chercher les mots et les pratiques à même d’associer, tant bien que mal, les forces contestatrices”.
Surtout, n'hésite pas à utiliser le formulaire de contact si besoin !
